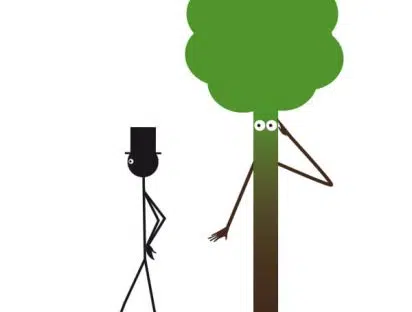Sans nier l’importance de ce phénomène, un article récemment publié dans le Journal of Applied Psychology propose des résultats empiriques qui vont à l’encontre de cette vision des choses (2). Il montre que, sous certaines conditions, le langage moral aurait plus d’effets pratiques que le langage économique lorsqu’il s’agit de défendre une cause relevant de l’intérêt général. Nous en discutons dans le présent article.
Les causes de la réticence à utiliser le langage moral
Susan Ashford et James Detert résumaient en 2015 la situation des managers désireux de proposer une nouvelle idée (non nécessairement morale) auprès de leur direction :
« Même lorsqu’ils expriment effectivement leurs idées, la plupart des managers éprouvent des difficultés à les ‘vendre’ à leurs supérieurs. Il leur est difficile de soulever des questions à un niveau ‘stratégique’ au début d’un processus de décision – à supposer qu’ils parviennent à y participer. Des études montrent que les cadres supérieurs rejettent très souvent les bonnes idées qui viennent de leurs subordonnés. Ces études soulignent que la raison principale de cet état de fait est que, s’ils ne perçoivent pas que l’idée en question a un effet sur la performance de leur entreprise, ils ne la jugent pas suffisamment importante pour mériter leur attention. Par conséquent, les cadres intermédiaires doivent s’efforcer de modifier cette perception. » (3)
La difficulté soulignée par Ashford et Detert est accrue lorsque les « idées » ont une nature morale. Frederick Bird et James Waters l’avaient abordée dans un article publié en 1989, dans lequel ils proposaient la notion de « mutisme moral » (4).
Selon la définition qu’ils en avaient proposé, cette notion n’implique pas que les managers accomplissent des actions non morales, faute de pouvoir exprimer des arguments moraux pour défendre une autre ligne de conduite. Elle signifie plutôt qu’ils tendent à décrire en des termes non moraux les actions morales qu’ils accomplissent au nom de leur organisation.
Selon Bird et Waters, le fait qu’un manager s’impose un tel silence serait provoqué par trois préjugés qui font partie de leur « théorie naïve » sur le fonctionnement d’une entreprise :
– le recours au langage moral est une source potentielle de confrontation ;
– le débat moral induit une perte d’efficacité dans le fonctionnement de l’organisation ;
– l’emploi d’arguments moraux dans le contexte de l’entreprise renvoie à des idéaux ou à des utopies qui, face à l’impératif de performance, sont jugés futiles. (5)
Le mutisme moral peut être surmonté
La question du mutisme des employés, qu’il soit moral ou relatif à des questions sociétales, a notamment été étudié dans le sillage des travaux de Jane Dutton and Susan Ashford (6). Susan Ashford a d’ailleurs contribué à la recherche dont nous discutons dans le présent article (2).
On y trouve des considérations aussi intuitives que celles que nous avons mentionnées jusqu’à présent à propos de la thèse de la séparation (voir la note 1) ou du mutisme moral. L’apparente évidence de ces considérations justifient qu’elles fassent l’objet de tests empiriques. C’est précisément la tâche qu’ont entreprise les quatre auteurs pour répondre à un aspect de la question présentée dans le titre de leur article : « L’argent ou la morale ? » (The money or the morals?).
Les auteurs s’efforcent de rechercher les conditions dans lesquelles le mutisme moral peut être surmonté pour laisser place à l’usage du langage moral. Ils examinent une circonstance spécifique dans laquelle ce type de langage pourrait être mobilisé : celle où des questions d’intérêt général sont en jeu (7).
Voici leurs principales observations.
a) La manière de présenter un argument relatif à une question relevant de l’intérêt général est un élément essentiel du processus de persuasion. Derrière ce truisme se trouve la nécessité, pour le locuteur, de s’adapter au cadre de référence du destinataire de son message.
b) Le préjugé selon lequel, pour défendre une perspective d’intérêt général, il est préférable d’expliquer en quoi elle présente un intérêt économique pour l’entreprise, revient à perpétuer le cadre de référence économique auquel ses membres se réfèrent pour juger et agir. Selon les termes des auteurs, ce préjugé a le caractère d’une « prophétie auto-réalisatrice ».
c) Il est donc important de combattre un tel préjugé, en montrant à quelles conditions l’usage d’un langage moral est préférable à celui d’un langage économique dans le contexte de questions d’intérêt général. Ainsi,
« l’utilisation du langage moral pourrait activer un cadre de référence moral conduisant à un comportement plus coopératif et plus pro-social pour aborder une question d’intérêt général. »
L’efficacité d’un argument dépend de sa consonance avec les valeurs déclarées par l’entreprise
d) L’apport des auteurs est, selon leurs propres mots, de considérer que la formulation d’une question d’intérêt général en termes moraux a d’autant plus de chances d’être persuasive qu’elle est en consonance avec les valeurs et / ou la mission de l’organisation. Elle est alors « plus légitime et plus consensuelle ».
Ces valeurs ne sont pas nécessairement celles qui sont révélées par les multiples actions accomplies au sein de l’organisation. Il s’agit des valeurs qu’elle déclare publiquement.
e) Il en résulte, soit dit en passant, que ceux qui désirent soulever une question d’intérêt général au sein de leur organisation doivent faire preuve de « souplesse », puisqu’ils doivent être capables de « concevoir différentes formulations d’un même message pour plaire à différents publics ».
f) Les auteurs considèrent deux mécanismes qui pourraient favoriser l’efficacité du langage moral (dans l’hypothèse où ce langage est consonant avec les valeurs et / ou missions de l’organisation). Ces mécanismes sont à l’œuvre non pas chez celui qui soulève une question d’intérêt général, mais chez le destinataire du message. Il s’agit de la motivation pro-sociale (orientée vers le bien-être d’autrui) et de la culpabilité anticipée.
Le premier mécanisme, en particulier, reflète la sensibilité morale du destinataire du message, qui pourrait par exemple considérer que l’argument moral qui lui est présenté est original et source d’inspiration.
Le langage moral peut s’avérer plus persuasif que le langage économique
g) À travers une série d’études, les auteurs ont testé l’hypothèse selon laquelle
« l’utilisation du langage moral est plus efficace lorsque la question est formulée de manière à correspondre aux valeurs et / ou à la mission de l’entreprise »,
ainsi que le rôle des deux mécanismes précités.
Si leurs premières études ont, pour des raisons expérimentales, donné des résultats contrastés, la conclusion générale est que
« contrairement aux recherches antérieures et aux croyances communes qui suggèrent qu’il est préférable d’utiliser un langage économique lorsqu’on défend des questions d’intérêt général sur son lieu de travail […], nous avons constaté que le langage économique est inefficace et que le langage moral peut être efficace lorsque la question est présentée comme consonante avec les valeurs et / ou la mission de l’entreprise. »
Des deux mécanismes testés, la motivation pro-sociale et la culpabilité anticipée, seul le second renforce l’effet de l’argument moral.
Conclusions des auteurs
Quelles conclusions pratiques les auteurs tirent-ils de leur étude ?
La première est une remise en cause des opinions préconçues relatives à la prédominance de la logique économique. Dans la mesure où ces opinions préconçues sont souvent le fait des employés eux-mêmes, elle les invite à considérer qu’ils ont, plus qu’ils ne le supposent, la liberté d’exprimer des arguments moraux.
Le second enseignement pratique a trait aux valeurs d’une entreprise. Celle-ci a intérêt à les renforcer, c’est-à-dire à les rendre plus saillantes. En effet,
« lorsque la mission et les valeurs de l’entreprise sont plus visibles pour ses employés, il leur est plus facile de réfléchir à la manière d’utiliser des arguments moraux pour défendre une position. »
Conclusion générale et critique
Ces conclusions sont séduisantes. Elles laissent imaginer une situation idéale dans laquelle les membres d’une organisation seraient capables d’aborder n’importe quelle question d’intérêt général, à condition qu’ils se débarrassent de leurs préjugés sur la logique économique de l’entreprise, qu’ils sachent choisir le bon registre de communication en fonction de leurs interlocuteurs, et, surtout, qu’ils « alignent » (un terme utilisé par les auteurs) leurs arguments moraux sur les valeurs et / ou la mission de leur entreprise.
Deux remarques pour conclure.
D’abord, le fait qu’un dirigeant soit convaincu par les arguments moraux d’un de ses collaborateurs parce que ces arguments sont alignés sur les valeurs de l’entreprise n’exclut pas que le dirigeant agisse pour des raisons non morales. Certes, les auteurs avancent le rôle positif joué par le sentiment de culpabilité anticipée, mais la valeur morale d’un tel sentiment n’est pas clairement évaluée.
Ensuite, l’insistance de l’article sur l’intelligence pratique d’un employé est plutôt troublante. Un employé souhaitant défendre une perspective d’intérêt général devrait en effet réfléchir à la place que les concepts moraux devraient avoir dans son argumentation.
Considérons la situation suivante :
(i) un employé peut choisir, par exemple, de parler de respect des droits humains pour défendre une position relative aux droits humains, sans se référer aux valeurs de son entreprise ;
(ii) il peut utiliser la même « tactique » (un terme employé par les auteurs de l’article), mais en se référant, cette fois, aux valeurs de son entreprise ;
(iii) ou il peut éviter le langage moral et mettre l’accent, par exemple, sur le risque de réputation pour son entreprise.
Cela ne signifie pas que cet employé choisira d’être (i) moral, (ii) conforme à la moralité déclarée par son entreprise, ou (iii) amoral. Il ne fera que choisir le langage le plus approprié pour exprimer sa position.
Sans doute, pensera-t-on, ce choix réfléchi n’affectera pas ses propres convictions. On supposera qu’il « sait faire la part des choses », que le contenu du langage qu’il utilise peut être, parfois, différent du contenu de ses croyances, et que cela n’a pas de conséquences. Mais sera-ce toujours le cas si ce genre d’exercice devient une habitude, et si l’on estime que l’habitude est une seconde nature ?
Alain Anquetil
(1) Cette incompatibilité pratique entre la logique économique et la pensée morale a été conceptualisée, dans l’éthique des affaires, par la « thèse de la séparation ». Voir R. E. Freeman, « The politics of stakeholder theory: Some future directions », Business Ethics Quarterly, 4(4), 1994, p. 409-421.
(2) D. M. Mayer, M. Ong, S. Sonenshein et S. J. Ashford, « The money or the morals? When moral language is more effective for selling social issues », Journal of Applied Psychology, 104(8), 2019, p. 1058-1076.
(3) S. J. Ashford & J. R. Detert, « Get the boss to buy in », Harvard Business Review, 93, 2015, p. 72-79.
(4) F. B. Bird et J. A. Waters, « The moral muteness of managers », California Management Review, 32(1), 1989, p. 73-88.
(5) Les contenus de ces trois préjugés sont issus de A. Anquetil, Qu’est-ce que l’éthique des affaires ? Paris, Vrin, « Chemins Philosophiques », 2008.
(6) Voir par exemple J. E. Dutton & S. J. Ashford, « Selling issues to top management », Academy of Management Review, 18, 1993, p. 397-428.
(7) Je traduis ainsi l’expression social issues, qui inclut, entre autres, des questions relatives aux relations de travail, aux droits des employés, à la diversité, à la discrimination, à la protection de l’environnement ou à la responsabilité sociale de l’entreprise.
(8) Pro-social signifie « au bénéfice de la société » (Collins Dictionary) et inclut « le souci d’autrui, la générosité et la bienveillance » (N. Eisenberg et P. Müssen, The roots of prosocial behavior in children, Cambridge University Press, 1989).
[cite]