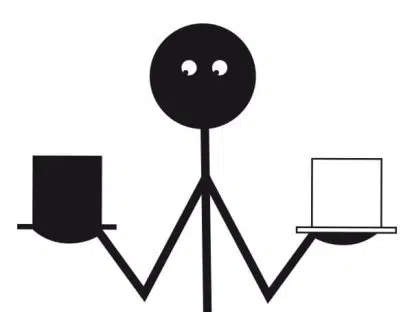Le terme « moralisation », souvent employé à propos du capitalisme depuis la crise financière de l’automne 2008, a un rapport direct avec « l’éthique des affaires » (la Business Ethics). En effet, ce champ disciplinaire, qui relève de l’« éthique appliquée », s’intéresse justement à la place de la morale dans la vie économique. Après une trentaine d’années de travaux académiques, essentiellement de langue anglaise, beaucoup de questions morales y ont été analysées et discutées. Et certaines théories ont potentiellement des conséquences surprenantes. Car tout en restant fidèles au modèle économique libéral, elles conduiraient, si elles étaient appliquées, à construire un monde différent du nôtre.
On pourrait penser que l’éthique des affaires a finalement pour seule vocation de justifier, à l’aide d’une rhétorique morale bien pensée, des pratiques fondées sur l’égoïsme d’acteurs pris dans le jeu sans merci de la compétition économique. Bref, de mettre de l’huile dans les rouages du système. Peut-être est-ce pour cette raison que les discours sur la moralisation en ont fait jusqu’à présent peu de cas, comme si l’éthique des affaires ne pouvait être dissociée des dérives éthiques du monde économique. Or, certains de ses développements véhiculent clairement une conception de la moralisation des affaires qui va au-delà d’un simple habillage rhétorique. Il est donc utile de souligner à quel point ils peuvent donner du sens à l’idée de « moralisation », voire converger de façon inattendue avec des critiques du capitalisme.
En général, la « moralisation », telle que la conçoivent la plupart des auteurs de l’éthique des affaires, laisse intacte la structure de base de la vie économique. Ce sont les règles de fonctionnement de cette structure (les régulations), et non ses principes, qu’il s’agit de « moraliser ». C’est certainement pourquoi, dans les discours, les termes « moralisation » et « régulation » ont souvent été confondus.
Mais l’ambition « moralisatrice » de certains développements de l’éthique des affaires va au-delà de la question des régulations. L’un d’eux s’est par exemple attaché à définir un nouveau contrat entre l’entreprise et la société, fondé sur une qualité différente des relations entre la firme et ses parties prenantes. La notion de souci d’autrui, qui a été largement théorisée par les éthiques féministes, celles de communauté ou encore de bien commun sont typiques de ces tentatives de moraliser la vie des affaires qui prennent pour cible un élément de la structure de base de la vie économique.
On aurait tort de considérer que ces tentatives ont eu peu d’effet sur les pratiques des acteurs. Car elles ont introduit de nouveaux termes dans le langage qui sert à décrire et à évaluer les pratiques de la vie des affaires – sans remettre en cause les principes de l’économie libérale, ce qui est un gage de crédibilité.
Un autre développement au sein de l’éthique des affaires en vue de moraliser les pratiques s’est attaqué au problème de l’intégration de l’individu dans la sphère économique. Ainsi Robert Solomon, s’inspirant de la philosophie d’Aristote, affirmait-il que « l’entreprise est avant tout une communauté », que ses membres devraient pouvoir chercher à y mener une vie bonne, à y exercer les vertus permettant de réaliser des biens typiquement humains, en particulier à y exercer leur intégrité, ce « pivot de toutes les vertus », ce « point fixe qui permet d’éviter une désintégration personnelle ». Eviter une telle « désintégration » suppose de ne pas isoler les différentes parties de sa propre vie. C’est pourquoi Solomon soulignait que « les bons employés sont de bonnes personnes » (1).
La vision portée par Solomon est celle d’un système dans lequel les professionnels (ceux de la finance par exemple) seraient sincèrement soucieux du bien-être général et assumeraient pleinement la responsabilité de leurs actes. Ce serait un système où chacun penserait que ce qui est bon pour lui est bon pour la communauté, où la morale aurait en quelque sorte plus d’importance que la régulation.
Cette vision illustre la grande portée que peuvent avoir certains développements de l’éthique des affaires. Les nouveaux modes de relation qu’elle décrit dépendent en effet de l’enracinement en chaque individu de convictions profondes sur les rapports de l’individu à la communauté, qui dépendent elles-mêmes des structures économiques et sociales. Au passage le problème de l’intégration, sur lequel elle repose, est proche de celui qu’André Gorz, philosophe d’inspiration anarcho-communiste, avait si clairement mis en évidence. Il distinguait en effet deux modes d’intégration des personnes dans une organisation productive : autonome et hétéronome. Et il affirmait que, dans ce dernier cas, l’intégration de la personne à son organisation a une nature « fonctionnelle », à l’instar des rouages d’une machine (2).
Bien sûr, la convergence entre la vision de Gorz et celle, inscrite dans le champ de l’éthique des affaires, de Solomon, est certainement limitée. Mais l’idée d’une société humaine dans laquelle les activités de production seraient réalisées sur un mode autonome et où les personnes seraient authentiquement intégrées au système économique leur est commune.
Cette convergence, et la portée de la « moralisation » défendue par Solomon comme par certains tenants d’un nouveau contrat entre l’entreprise et ses parties prenantes, soulignent les contributions que l’éthique des affaires peut apporter aux réflexions sur le fonctionnement du système économique.
Alain Anquetil
(1) Robert C. Solomon, « Corporate roles, personal virtues: An Aristotelean approach to business ethics », Business Ethics Quarterly, 2(3), 1992, p. 317-339.
(2) André Gorz, Métamorphoses du travail : Critique de la raison économique, Paris, Folio Gallimard, 1988.