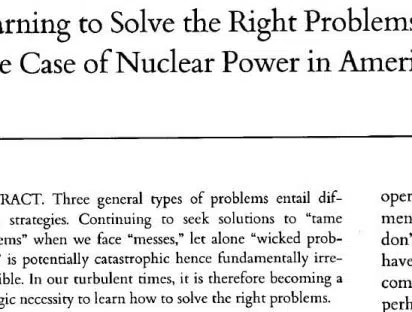Il a été plusieurs fois question, la semaine passée, de la catastrophe sanitaire et humaine qui a été provoquée par l’utilisation industrielle de l’amiante. Une phrase a frappé les esprits : le « cynisme incroyable avec lequel des connaissances scientifiques [relatives au danger de l’amiante pour la santé] ont été balayées par appât du gain ». Cette phrase accompagnait un jugement du tribunal civil de Bruxelles condamnant l’entreprise Eternit à verser 250.000 euros de dommages et intérêts à une famille de victimes. Les difficultés rencontrées par les victimes pour défendre leurs droits devant la justice, spécialement la justice pénale, ont également été soulignées. Elles témoignent d’une répartition des pouvoirs défavorable aux individus. Le problème posé par un tel déséquilibre des pouvoirs est bien connu de l’éthique des affaires académique. Ainsi, certains défenseurs de la théorie des parties prenantes prennent en quelque sorte le parti des individus lorsque ceux-ci ont des revendications légitimes à faire valoir à l’égard d’une firme.
1.
C’est « la première victoire d’une simple famille contre la multinationale Eternit », a déclaré le bénéficiaire du jugement du tribunal civil de Bruxelles qui a été prononcé le lundi 28 novembre dernier. Sa mère, victime « environnementale » de l’amiante, est décédée en 2000 d’un cancer de la plèvre (1).
Le mardi 29 novembre, Arte a diffusé un documentaire intitulé « Poussière mortelle ». Il portait sur « le grand procès de l’amiante », un procès pénal qui se tient à Turin depuis fin 2009. Début juillet 2011, le procureur de Turin a requis 20 ans de prison à l’encontre de deux dirigeants d’Eternit. Les parties civiles demandent un dédommagement de 5 milliards d’euros – 2 milliards pour les malades (près de 3.000), 1 milliard pour la Sécurité sociale italienne, 2 milliards au titre des dommages causés à l’environnement.
Le samedi 3 décembre, le journal d’informations de France Culture diffusait un reportage sur les anciens verriers de Givors qui souffrent de cancers. Ils essaient d’obtenir la reconnaissance officielle du caractère professionnel de leur maladie, qu’ils estiment liée, entre autres, à l’amiante. Le reportage affirme que « chaque action se heurte à un mur de résistances multiples : la direction des anciennes verreries, qui refuse de signer l’attestation d’exposition aux produits toxiques ; les dossiers médicaux expurgés : l’Assurance maladie, qui refuse de reconnaître la maladie professionnelle malgré des taux d’incapacité de plus de 25%. Autant de dénis de droit qui interdisent aux salariés malades d’aller même en justice ». Début juin 2011, le journal Viva notait que « le cas de cette verrerie symbolise toutes les limites de la législation actuelle – qui pourtant spécifie que l’employeur a obligation de délivrer une attestation d’exposition dans tout cas d’exposition à des produits cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques (Cmr) – et tous les freins rencontrés par les salariés dans leurs démarches. »
2.
Beaucoup des commentaires figurant dans les médias portent sur la logique des Fonds d’indemnisation, notamment le fait que les victimes de l’amiante qui recourent à ces Fonds renoncent à intenter des poursuites pénales sauf si une faute intentionnelle peut être prouvée. D’autres commentaires dénoncent l’impunité des entreprises industrielles et invoquent la nécessité d’appliquer le principe pollueur – payeur.
De leur côté, les travaux menés au sein de l’éthique des affaires académique qui se sont intéressés à la catastrophe de l’amiante ont souvent proposé des analyses morales inspirées du cas Johns Manville, cette firme industrielle américaine qui fit le choix, en 1982, de se placer sous le régime des faillites (le « chapitre 11 » de la loi sur les faillites aux États-Unis) pour éviter d’avoir à prendre en charge les conséquences financières des procès que leur auraient intenté les victimes de l’amiante. La décision opportuniste de Johns Manville fut largement commentée parce que ce groupe était alors classé au 181ème rang mondial par le magazine Fortune et qu’il disposait d’importants actifs financiers.
Mais ces analyses ne s’intéressent pas spécifiquement aux déséquilibres de pouvoir entre les victimes, en particulier les personnes, et les firmes qu’elles accusent d’être responsables de leurs maladies. Pourtant on trouve, dans l’éthique des affaires académique, des arguments qui, d’une part, dénoncent le caractère moralement problématique de ces déséquilibres de pouvoir, et qui, d’autre part, prennent le parti – ou reviennent à prendre le parti – des individus face aux organisations lorsque ces individus ont des revendications légitimes à faire valoir. Ces arguments sont notamment exposés dans le cadre du modèle théorique dominant de cette discipline : la théorie des parties prenantes.
Cette théorie affirme d’une façon générale que les firmes doivent « se soucier » de leurs parties prenantes, c’est-à-dire qu’elles doivent les identifier dans chaque situation de choix, évaluer leurs revendications et prendre in fine des décisions équilibrées. Pour certains défenseurs de la théorie, ce « souci » est tout à fait concret. Il dénote une authentique préoccupation pour autrui qui est de la même espèce que celle qui devrait se manifester dans les relations interpersonnelles.
Il n’est pas étonnant que ceux qui se sont inspirés de l’éthique du care (dite aussi éthique du souci d’autrui ou éthique de la sollicitude), d’inspiration féministe, aient insisté sur l’importance de cette relation. Pour eux, « autrui » ne désigne pas une catégorie de personnes comme « les fournisseurs », « les clients » ou, dans le cas en question, « les victimes de l’amiante », mais des personnes particulières. Le terme « autrui » n’est pas impersonnel et général, il est fondamentalement personnel et particulier.
C’est exactement la thèse que défendent Wicks, Gilbert et Freeman dans un article publié en 1994 (2). Ils y affirment par exemple que « les buts essentiels de l’entreprise tels que les conçoivent les théoriciens féministes [visent à] créer de la valeur pour des personnes spécifiques, promouvoir des projets personnels et encourager les relations entre différentes parties prenantes ». Et ils défendent l’idée selon laquelle « la solidarité préserve la possibilité de parler au nom de personnes particulières et de se soucier de leurs besoins ». Dans le même esprit, Burton et Dunn soulignent que « la théorie des parties prenantes offre la possibilité de faire des parties prenantes des entités concrètes. La question n’est pas de traiter avec « les fournisseurs » mais avec le fournisseur de ce produit, de cette matière première ou de ce service. La question est celle du type d’effet de votre décision sur ce fournisseur particulier et non sur « les fournisseurs » en général. » (3)
3.
On aurait tort d’écarter ce genre d’argument au motif qu’il serait idéaliste ou inadapté au contexte des relations professionnelles. Car on peut montrer de différentes façons que les arguments de Wicks, Gilbert et Freeman et de Burton et Dunn sont à la fois réalistes et adaptés à la vie des affaires. L’une des façons de le montrer est de mettre en avant l’enrichissement individuel et collectif qui résulte de relations humaines gouvernées par le souci d’autrui. Il est aussi possible d’insister sur l’importance morale de la coopération et des biens humains qu’elle tend à réaliser. On peut enfin invoquer l’importance du lien de confiance qui devrait exister entre les individus et les titulaires des différents pouvoirs – politiques, administratifs, économiques, judiciaires.
Ce dernier argument est spécialement pertinent aujourd’hui. Car traiter de façon impersonnelle les personnes ayant des revendications légitimes, c’est-à-dire les considérer seulement comme des détenteurs d’intérêts, concourt à alimenter la défiance envers les différents types de pouvoirs organisés. Cette défiance est présente sous différentes formes. Elle imprègne par exemple les revendications et les protestations dont les mouvements des « indignés » sont un exemple. Elle a été clairement exprimée par Éric Dupin, auteur de Voyages en France, paru en 2011, dans une interview à France 2 : « J’ai constaté un état de défiance assez généralisé et profond vis-à-vis des élites politiques, journalistiques et économiques. C’est symptomatique aussi d’une crise de la représentation. » Et très récemment, dans une interview au journal La Tribune du 1er décembre, Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental, affirmait que « le discrédit de la parole publique, la perte de confiance dans toutes celles et ceux qui exercent des autorités, est un facteur extrêmement préoccupant ».
La théorie des parties prenantes, spécialement dans sa version féministe, est susceptible de répondre à ce genre de défiance. Si ses principes fondamentaux étaient intégralement mis en œuvre, il en résulterait sans doute un équilibre des pouvoirs beaucoup plus favorable aux individus. Mais un tel changement ne pourrait advenir qu’à condition que la théorie des parties prenantes ait une véritable portée politique.
Alain Anquetil
(1) Les victimes « environnementales » ont contracté une maladie liée à l’amiante sans avoir travaillé dans un établissement industriel où était employée cette matière première. La contamination pouvait provenir des poussières ramenées à son domicile par un proche travaillant dans l’usine.
(2) A.C. Wicks, D.R. Gilbert et R.E. Freeman, « A feminist reinterpretation of the stakeholder concept », Business Ethics Quarterly, 4(4), 1994, p. 475-497 ; tr. fr. Laugier C., « Une réinterprétation féministe du concept de partie prenante », in Anquetil A. (dir.), Textes clés de l’éthique des affaires, Paris, Vrin, 2011.
(3) B.K. Burton et C.P. Dunn, « Feminist ethics as moral grounding for stakeholder theory », Business Ethics Quarterly, 6(2), 1996, p. 133-147.