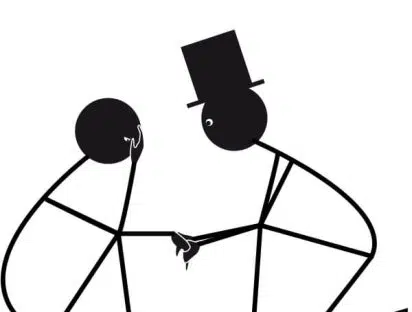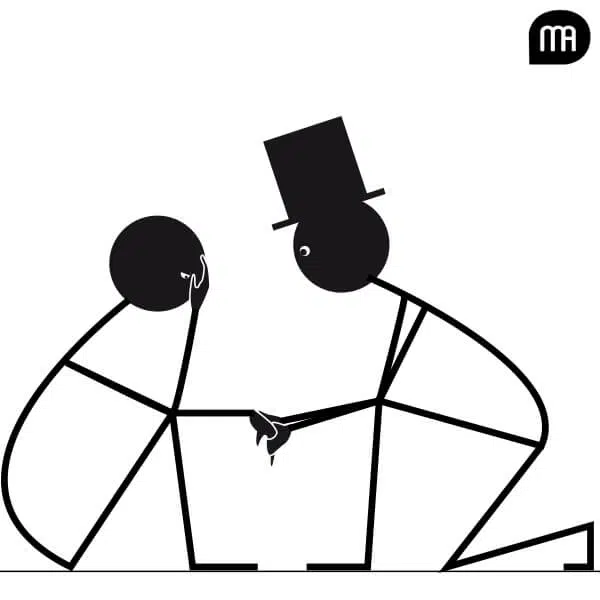
La nécessité d’une affliction
La première condition de la consolation est un malheur, une douleur, une affliction. On ne console pas sans une raison qui réside dans la situation d’autrui, et on ne console pas quelqu’un de la joie qu’il éprouve (1). Mais cette condition, qui semble aller de soi, mérite un bref développement. Les raisons de consoler et les arguments utilisés à cette fin sont présents dans le genre littéraire de la consolation. Ayant son origine dans l’Antiquité, il prit des formes diverses, par exemple dialoguées, épistolaires et poétiques. Dans la mesure où son sujet privilégié est le deuil, le discours de consolation entretient un rapport étroit avec la philosophie. « En tant que genre et qu’interrogation existentielle, la consolation nous ramène […] aux sources même de la philosophie, aux questions les plus essentielles, celles qui conduisent à utiliser la raison et le savoir, mais aussi l’exercice de cette rationalité pour les mettre au service de la création d’une vie qui soit la plus libre possible », observe Claudie Martin-Ulrich dans son introduction à un numéro de la revue Exercices de Rhétorique consacré à ce thème (2). Les raisons de consoler sont de deux natures. Elles sont à la fois particulières – il s’agit de réconforter une personne : ainsi, dans sa Consolation à Helvia, Sénèque (4 av. J.C.-65) console sa mère, qui avait perdu son mari et d’autres membres de sa famille ; François de Malherbe (1555-1628) écrit un poème à l’attention d’un ami qui a perdu sa fille Marguerite, où l’on trouve ce vers célèbre : « Et rose elle a vécu ce que vivent les roses, / L’espace d’un matin » (3) – et exemplaires, donc générales. Manfred Kern considère que cette double nature est typique de la littérature de consolation :
« [Elle] se propose de traiter un cas individuel qu’elle présente en même temps comme un cas exemplaire. Ce décalage apparent culmine, d’une part, dans le ton intime de la littérature de consolation et, d’autre part, dans une organisation rhétorique et thématique quasi exemplaire du genre. Le passage dialectique de l’individuel à l’exemplaire […] a été réalisé de façon caractéristique dans la littérature de consolation. » (4)
Le caractère « exemplaire » n’implique pas que la consolation ne puisse être qu’une forme permettant à son auteur d’exposer sa propre conception philosophique – certaines œuvres paraissent dénuées de la part intime et empathique nécessaire au réconfort, comme la Consolation à Appolonius attribuée à Plutarque (46-125), jugée « froide et compassée » (5). Il est nécessaire que le propos vise d’abord à soulager la personne à laquelle il s’adresse. Selon les mots de Jules César Scaliger (1484-1558) :
« La consolation est un discours qui rend sa tranquillité à l’âme de celui qui est affligé. Elle ne peut venir que d’un ami. » (6)
L’intervention de la sympathie
La deuxième condition de la consolation est la sympathie. Elle semble aller de soi. Lorsque Adam Smith, au début de sa Théorie des sentiments moraux, affirme que « nous sympathisons même avec les morts », il considère comme une évidence que la sympathie est une condition nécessaire de la consolation – même si, dans le cas d’espèce, tout réconfort semble inutile :
« Que notre sympathie ne puisse leur apporter aucune consolation semble être un accroissement de leur malheur ; penser que tout ce que nous pouvons faire est vain et que les regrets, l’amour et les lamentations de leurs amis, qui atténuent toute autre sorte de détresse, ne peuvent leur apporter aucun réconfort, tout cela sert seulement à exaspérer notre sens de leur misère. » (7)
La sympathie à laquelle Smith se réfère est un mécanisme psychosocial qui permet à une personne, grâce à l’imagination, de se placer dans la situation d’une autre, d’entrer « pour ainsi dire à l’intérieur de son corps », selon les mots de Smith, de devenir l’autre « dans une certaine mesure » (8). Mais ce mécanisme ne débouche pas automatiquement sur une affinité de sentiments. En voici un exemple, proposé par Smith, où un criminel perçoit (par sympathie) la haine que les autres ont pour lui. Son crime accompli, il éprouve le regret, la terreur et la solitude :
« Celui qui viole les lois les plus sacrées de la justice ne peut jamais réfléchir sur les sentiments que le genre humain nourrit à son égard sans sentir toutes les souffrances de la honte, de l’horreur et de la consternation. […] En sympathisant avec la haine et l’horreur que les autres doivent nourrir à son égard, il devient en quelque sorte l’objet de sa propre haine et de sa propre horreur. La situation de la personne qui souffre par son injustice appelle maintenant sa pitié. Il est affligé en y pensant. […] Il n’ose plus regarder la société en face, il s’imagine lui-même rejeté et banni de l’affection de tout le genre humain. Il ne peut pas, dans sa détresse la plus grande et la plus épouvantable, espérer la consolation de la sympathie. Le souvenir de ses crimes a fermé le cœur de ses semblables à toute affinité avec sa détresse. »
L’importance du remords
La troisième condition s’applique spécifiquement au cas d’une personne éprouvant de la détresse en raison d’un préjudice qu’elle a fait subir à autrui. La situation du criminel imaginée par Smith en est une illustration typique. La souffrance de celui qui a violé les lois les plus sacrées de la justice ne s’arrête pas à la réprobation dont il est l’objet. Sa douleur morale le conduit à la solitude. Or, celle-ci lui apparaît plus insupportable encore que la condamnation sociale. Aussi finit-il par rechercher, non pas le rachat, le pardon et la consolation, mais un appui quelconque, une reconnaissance de sa peine, que Smith appelle « protection » :
« Mais la solitude est encore plus effrayante que la société. Ses propres pensées ne peuvent rien lui offrir d’autre que de noir, d’infortuné et de désastreux, que des pressentiments mélancoliques d’une misère et d’une ruine incompréhensible. L’horreur de la solitude le ramène dans la société et il se trouve à nouveau en présence du genre humain, stupéfait, accablé par la honte et égaré par la crainte, pour implorer un peu de protection du visage de ces juges mêmes dont il sait qu’ils l’ont déjà tous unanimement condamné. Telle est la nature de ce sentiment proprement appelé remords. De tous les sentiments qui peuvent pénétrer le cœur de l’homme, il est le plus redoutable. Il est composé de la honte provenant du sens de l’inconvenance d’une conduite passée, de la douleur face aux effets de celle-ci, de la pitié pour ceux qui en souffrent, et de la crainte et de la terreur du châtiment suscitées par la conscience d’un ressentiment justement provoqué en toute créature raisonnable. » (9)
Si le criminel peut espérer gagner quelque protection de ses congénères, c’est grâce au remords qu’il finit par éprouver. Cette émotion « redoutable », les spectateurs peuvent y être sensibles par sympathie et laisser au criminel une chance de conserver une place dans la société. On trouve des commentaires similaires dans la psychologie contemporaine. Ainsi, le fait, pour l’auteur d’un tort, d’admettre sa responsabilité, de manifester du remords, de témoigner du fait qu’il paie lui-même un coût psychique en raison de l’acte qu’il a commis, tout ceci rétablit la justice, suggère que l’acte immoral ne se reproduira pas et contribue au maintien des relations sociales (10). Cependant, le remords n’est pas dénué d’ambiguïté morale. Appliqué au criminel de Smith, il n’implique pas logiquement l’effacement de sa faute. C’est que le remords peut être conçu comme un sentiment égoïste, au sens où il ne serait pas accompagné de l’intention de réparer le tort commis et de la promesse de ne pas recommencer. Les critères proposés par Smith – honte, douleur, pitié, peur du châtiment – ne garantissent pas que le remords conduise à une action réparatrice. C’est une question qui mérite un développement particulier, incluant la distinction entre le remords et le repentir. Nous en parlerons dans notre prochain article, qui conclura notre parcours sur la consolation.
Alain Anquetil
Références
(1) Mais l’un des sens de la consolation est « une sorte de joie ». Ce sens rejoint celui de compensation, que nous évoquions dans le précédent article, ou de « contrepoids ». Voici ce qu’écrivait René Bailly dans le Dictionnaire des synonymes de la langue française (sous la direction de Michel de Toro, Paris, Librairie Larousse, 1947) :
« Contrepoids, [en un sens figuré], ne s’applique qu’aux affections, aux qualités bonnes ou mauvaises, et, en général, à toutes les choses morales, politiques, etc., qui servent à en contrebalancer d’autres : Son avarice est un fâcheux contrepoids à ses bonnes qualités.
Consolation est un synonyme plutôt familier de contrepoids pris en bien, auquel il ajoute l’idée d’un certain soulagement et même d’une sorte de joie : Enfant qui donne de grandes consolations à ses parents. »
On pourra aussi se référer à l'ouvrage de Michaël Foessel, Le temps de la consolation, Paris, Seuil, 2015.
(2) C. Martin-Ulrich, « Présentation : consolation et rhétorique », Exercices de rhétorique, 9, 2017.
(3) Consolation à M. du Périer, dans Poésies de F. Malherbe, Paris, Charpentier et Cie Libraires-Editeurs, 1874.
(4) Voir aussi J. H. D. Scourfield , « Towards a genre of consolation », in H. Baltussen (dir.), Greek and Roman consolations: Eight studies of a tradition and its afterlife, Classical Press of Wales, 2013. Il cite cette définition de Wilhelm Kierdorf :
« Ce qu’on entend par consolatio en tant que genre littéraire, […] ce sont des écrits à tendance philosophique, dont les auteurs tentent soit de dissuader les individus de faire leur deuil face au malheur, soit de proposer des conseils généraux pour surmonter l’adversité. » (« Consolatio as a literary genre », in H. Cancik & H. Schneider (dir.), New Pauly Online: Encyclopaedia of the ancient world, Leiden, Brill, 2005.)
(5) Voir R. Flacelière, revue de Jean Hani, Plutarque. Consolation à Apollonios, L’antiquité classique, 42(1), 1973, p. 251-253.
(6) Poetices libri septem (1561), III, 122. « La Consolation ». Traduction et notes de Christine Noille, dans Exercices de rhétorique, 9, 2017.
(7) A. Smith, The theory of moral sentiments, 1759, D. D. Raphael et Alec L. Macfie (dir.), Oxford University Press, 1976, tr. M. Biziou, C. Gautier et J.-F. Pradeau, Théorie des sentiments moraux, PUF, 1999.
(8) Voir mon récent texte sur Adam Smith : « The free liberalism of Adam Smith », in T. Hoerber & A. Anquetil (dir.), Economic theory and globalization, Palgrave Macmillan, 2019.
(9) A. Smith, The theory of moral sentiments, op. cit.
(10) Voir par exemple R. F. Baumeister, A. M. Stillwell & T. F. Heatherton, « Guilt: An interpersonal approach », Psychological Bulletin, 115, 1994, p. 243-267, et M. O’Malley & J. Greenberg, « Sex differences in restoring justice: The down payment effect », Journal of Research in Personality, 17, 1983, p. 174-185.