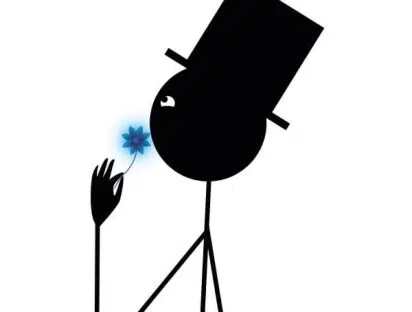« L’œuf tel qu’il doit être » est caractéristique de l’une des cinq valeurs du groupe Cocorette, qui produit des œufs fermiers de tradition, Label Rouge et bio. Lors du séminaire « Aventures industrielles » organisé par L’Association des Amis de l’École de Paris du management, dont le compte-rendu figure dans le numéro de juillet/août 2015 du Journal de l’École de Paris du management, le PDG de Cocorette, Thierry Gluszak, décrivait le développement de son groupe et son positionnement sur le marché très concurrentiel de l’œuf au sein duquel les élevages industriels, intensifs, sont encore dominants en volume, malgré un recul spectaculaire depuis 10 ans (1). Dans cet article, je pars de « L’œuf tel qu’il doit être » pour faire ressortir trois valeurs fondamentales relatives à l’activité économique en général, qui seront développées dans le prochain article.
Selon les termes de Thierry Gluszak, les cinq grandes valeurs de Cocorette sont : une alimentation de qualité ; le respect du bien-être animal ; la production d’un œuf de qualité ; la proximité et le territoire ; le développement durable et la responsabilité. Cette liste est typique d’un énoncé de valeurs attaché aux pratiques concrètes dont l’existence dépend de la raison d’être de l’entreprise et de sa vision. Le lien entre vision et pratiques apparaît notamment dans la description de la troisième valeur, « Un œuf de qualité » :
« Notre vision de notre produit est celle de « L’œuf tel qu’il doit être, en respectant le rythme naturel de la poule. Un œuf au bon goût, avec de beaux jaunes et une coquille solide ». »
Le lecteur n’a aucun mal à comprendre l’énoncé « L’œuf tel qu’il doit être ». Il ne contient aucune ambiguïté. Le produit, l’œuf en personne, est le sujet de la phrase, que la seconde partie (« en respectant le rythme naturel de la poule ») réfère à la nature, si bien que toute la phrase peut être comprise comme une description de « l’œuf naturel », même s’il est produit au sein d’un élevage, non dans la vraie nature. Il s’agit de donner à la poule les conditions qui correspondent à l’une de ses fonctions propres, puis de laisser faire, comme en atteste le ramassage à la main. Ces conditions incluent l’élevage en plein air, la ponte des œufs dans des « nids en bois garnis de paille » où la poule, comme dans la nature, pourra demeurer le temps nécessaire pour permettre à la cuticule (une membrane externe organique qui protège la surface de la coquille) « de sécher et d’obturer ainsi les 7.500 pores de l’œuf ».
En première analyse, ces éléments dénotent une synthèse harmonieuse entre les valeurs économiques et écologiques. Au sein des cinq valeurs de Cocorette, le respect du bien-être animal et le principe de « L’œuf tel qu’il doit être » semblent en effet s’accorder avec la recherche du profit mais aussi avec le développement et le maintien d’un réseau d’éleveurs (au nombre de 330 selon l’article précité) dont le groupe s’engage à acquérir la production. Un aspect important du mode d’organisation promu par Cocorette est la limitation de la taille des exploitations, qui est au maximum de 3.000 poules – les élevages en batterie, où les poules sont maintenues en cage, comportent en moyenne 300.000 animaux par bâtiment. Dans le cas de Cocorette, l’expansion économique porte sur le nombre d’éleveurs, non sur la taille des unités.
Les unités géantes, parfois appelées « fermes-usines » (2), sont justement cette semaine le sujet d’un article du journal Télérama, qui traite des effets de l’élevage intensif sur le climat (« Un effet bœuf sur le climat »). On y lit qu’« entassés dans des hangars toujours plus grands, bovins, porcs, volailles se gavent d’aliments massivement importés (à hauteur de 77 % pour l’élevage européen) ». De tels systèmes industriels ont des effets secondaires économiques et écologiques, les aliments étant importés « en particulier du Brésil, où l’on rase la forêt amazonienne, poumon de la planète, pour laisser place à de gigantesques champs de soja – transgénique essentiellement – imprégnés d’engrais et sillonnés de gros tracteurs ». Et le journaliste souligne qu’« à cela, il faut ajouter les transports de céréales et de viande aux quatre coins de la planète, le stockage et le traitement des effluents (les fumiers et lisiers), les quantités astronomiques d’eau utilisées pour nettoyer les sols bétonnés… »
L’article de Télérama cite également Jocelyne Porcher sur le sujet spécifique de la taille des exploitations : « Le productivisme et la recherche forcenée du « toujours plus » ont entraîné les éleveurs dans une course sans fin. Toujours plus de lait, de porcelets, d’agneaux… Toujours plus vite, toujours plus de profits pour les investisseurs de l’industrie de la viande et de l’agroalimentaire, de la pharmacie, de la génétique, du bâtiment, de la banque… » (3). La tendance à l’expansion, à l’augmentation de la taille des exploitations de production animale, renvoie à une autre valeur, relative à l’expansion et au pouvoir – une valeur qui n’est pas endossée par Cocorette puisque le groupe est précisément fondé sur un réseau de « petits élevages familiaux » (je mets les italiques).
Les grandes unités d’élevage industriel n’ont pas que des effets économiques et écologiques : elles influencent également la manière dont se construisent les représentations mentales afférentes aux animaux destinés à la production, en particulier chez les éleveurs eux-mêmes. Dans un article publié en 2010, Jocelyne Porcher et Tiphaine Schmitt comparent le travail humain, dont l’organisation fut pensée sur un mode productiviste taylorien, et le travail des animaux regroupés dans de telles unités industrielles : « À l’instar du concept de travail humain fondé sur une représentation mécanique de la « machine humaine » », écrivent-elles, « la construction de la zootechnie comme « science de l’exploitation des machines animales » s’appuie sur les notions d’énergie et de rendement. » (4) (5) Des méthodes industrielles que mettent en pratique les salariés des filières de productions animales, il résulte des représentations mentales qui ne peuvent que s’opposer au respect des animaux, à tout le moins le déprécier ou l’écarter du devant de la scène.
C’est ainsi que Jocelyne Porcher peut comparer l’élevage de porcs à la production de chaussures (6). Il est bien entendu que les travailleurs concernés font la différence entre les deux types d’activités, mais, indique-t-elle, « par leur travail même – et rappelons que, comme l’écrivait Marx, c’est le travail qui construit les représentations et non l’inverse –, ils savent aussi le contraire ». De cet effet du travail et de la répétition laborieuse, il résulte un effacement de la sensibilité morale, que l’auteure exprime en ces termes :
« Où est la limite entre la chaussure et le cochon ? Pour le travailleur, cette limite est imprécise et, du fait de l’organisation du travail, toujours repoussée plus loin. Où est la frontière entre le vivant et l’inerte, entre le vivant et le mort ? Les travailleurs ne le savent pas et les chercheurs ne le savent pas davantage. Car, après tout, ce cochon-chaussure, il est à notre pointure, partout dans nos sandwichs, nos croque-monsieur, nos endives au jambon, nos salades… Difficile de trouver quelque chose à manger où il n’est pas, lui, ou son semblable, le poulet-chaussure, la dinde-chaussure, le veau-chaussure… »
Résumons notre propos. Dans l’exposé de ses valeurs, dont « L’œuf tel qu’il doit être » apparaît comme une sorte de leitmotiv, le groupe Cocorette semble exprimer la volonté de combiner deux types fondamentaux de valeurs : les valeurs économiques et les valeurs écologiques, et de rejeter ou minimiser les valeurs de pouvoir et d’expansion. Il se trouve que ces trois types de valeurs – économiques, écologiques, relatives au pouvoir – pourraient suffire à caractériser la vie économique marchande. C’est du moins la thèse du professeur américain William Frederick qui, au cours des années 1990, a proposé, dans le champ de l’éthique des affaires, une théorie naturaliste des valeurs de la firme. Je l’aborderai dans le prochain article.
Alain Anquetil
(1) Selon Jocelyne Porcher, directrice de recherche à l’INRA, l’expression « élevage industriel » est un oxymore, la finalité de l’élevage étant incompatible avec les méthodes de l’industrie. C’est ce que souligne Alain Caillé dans la préface de l’un de ses ouvrages : « Avec les « productions animales » ou encore « l’élevage industriel », expression que Jocelyne Porcher rejette puisque, précisément, il ne s’agit plus d’élevage, les animaux, parqués, attachés, engraissés artificiellement, bourrés d’hormones, sont en effet réduits à l’état de machines à profit. » (préface à J. Porcher, Vivre avec les animaux. Une utopie pour le XXIe siècle, La Découverte, 2011).
(2) Cf. l’article du Parisien « Après la « ferme des 1000 vaches »», la ferme des 250 000 poules » du 5 octobre 2014.
(3) Extrait de Vivre avec les animaux. Une utopie pour le XXIe siècle, op. cit.
(4) J. Porcher et T. Schmitt, « Les vaches collaborent-elles au travail ? Une question de sociologie », Revue du MAUSS, 35(1), 2010, p. 235-261.
(5) Selon le dictionnaire du CNRTL, la zootechnie est une « discipline d’application procédant des sciences les plus diverses et dont le but est l’étude technique et économique des productions animales, et de l’élevage en général« (…). La zootechnie générale (…) étudie les méthodes d’amélioration [de l’élevage des animaux domestiques] et comprend plusieurs disciplines (anatomie et physiologie, connaissance des animaux, amélioration génétique, alimentation, hygiène, conduite des élevages), et la zootechnie spéciale (…) est l’application de l’ensemble de ces méthodes à une production donnée (lait, viande, œufs, laine, etc.). »
Selon Jocelyne Porcher, « La zootechnie, science de l’exploitation raisonnée des animaux domestiques, va concourir à faire d’une grande partie des activités d’élevage un processus industriel spécialisé et rentable, et des éleveurs liés à ces industries les ouvriers actifs et apparemment sans état d’âme d’une production massive de matière animale 2, coupés de leur histoire et de celle de leurs animaux, travaillant de plus en plus en « hors sol », c’est-à-dire séparés du milieu naturel, ces « producteurs » vont devoir œuvrer sur un temps raccourci et circonscrit aux seules limites de leur filière. » (J. Porcher, « Tu fais trop de sentiment », « Bien-être animal », Répression de l’affectivité, Souffrance des éleveurs », Travailler, 8(2), 2002, p. 111- 134.)
(6) J. Porcher, « Élevage/industriel : penser l’impensable ? », Travailler, 14(2), 2005, p. 9-20.