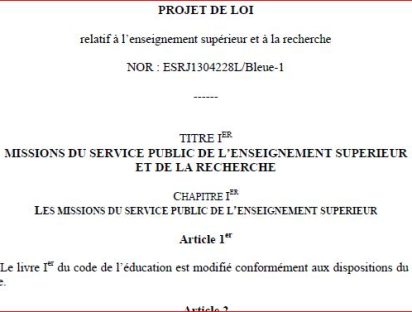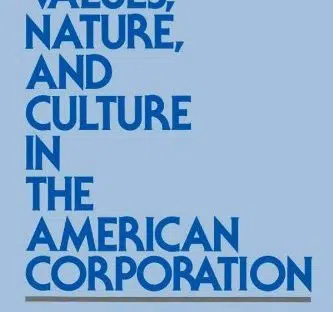Notre précédent article s’achevait sur deux orientations possibles de la vertu de tempérance : une orientation vers le soi et une orientation vers autrui. On considère généralement que la tempérance possède la première orientation. Elle serait une vertu individuelle ou personnelle, avant d’être une vertu collective ou sociale. Il y a toutefois différentes façons de défendre l’idée que la tempérance peut contribuer au bien-être d’autrui et au bien-être général. Nous en discutons dans le présent article.
1.
« Sortir de son moi » grâce à la tempérance
À première vue, tout ramène la tempérance à la vie intérieure. L’idée que quiconque possède et exerce cette vertu le fait en vue de son propre bien-être semble naturelle. Il suffit d’énoncer sa définition : « Disposition à restreindre et à modérer ses appétits impulsifs et inappropriés » (1). Si la personne qui éprouve ces « appétits impulsifs et inappropriés » cherche à les contenir en exerçant sa vertu de tempérance, c’est pour modifier sa propre situation intérieure, non celle d’autrui. Ses désirs lui appartiennent, et même si elle peut, dans certains cas, recevoir une aide extérieure afin de les contenir, cela reste fondamentalement son affaire.
Dans sa description du fonctionnement psychologique de la personne tempérante (l’« homme modéré », voir la note 2), Aristote suggère que cette vertu opère seulement pour son bien :
« Quant à l’homme modéré, il se tient dans un juste milieu à cet égard. Car il ne prend pas plaisir aux choses qui séduisent le plus l’homme déréglé (elles lui répugnent plutôt), ni généralement à toutes les choses qu’on ne doit pas rechercher, ni à rien de ce genre d’une manière excessive, pas plus qu’il ne ressent de peine ou de plaisir à leur absence (sinon d’une façon mesurée), ni plus qu’on ne doit, ni au moment où il ne faut pas, ni en général rien de tel. » (2)
La définition suivante, qui s’inscrit dans le cadre de la conception chrétienne de la tempérance, met en exergue la « régulation », par la personne, de ses propres intérêts égoïstes. Cependant, elle présente implicitement cette vertu comme la condition nécessaire qui lui permet de se détacher de la tendance de chaque être humain à se replier sur son moi – ou, pour reprendre l’expression d’Iris Murdoch, à être aveuglé par son moi (3) :
« La tempérance (également appelée modération ou maîtrise de soi) cherche à modérer les défauts et les excès ; elle régule ainsi les intérêts égoïstes lors de la prise de décision. » (4)
La possibilité que la tempérance puisse libérer, dans une certaine mesure, la personne des forces de son moi, Pablo Sanz et Joan Fontrodona l’ont clairement affirmée dans le texte que nous avons commenté dans notre article précédent (5). Après avoir noté que, dans la mesure où elle a pour fonction la maîtrise des désirs, « la tempérance est la vertu par laquelle l’être humain est en véritable possession de lui-même », ils considèrent que la possession et l’exercice de la tempérance sont des conditions nécessaires pour le développement moral et l’accès à des biens moraux :
« La tempérance devient une condition nécessaire (bien qu’elle soit évidemment non suffisante) pour atteindre toutes les autres vertus. En particulier, les philosophes de la Grèce antique admettent en général que l’absence de tempérance empêche l’être humain d’atteindre d’autres biens que le plaisir, notamment des biens moraux ou intellectuels. »
2.
La tempérance, vertu cardinale de la vie des affaires
C’est un premier pas vers un élargissement de l’horizon de la tempérance. On trouve, dans l’éthique des affaires académique, différentes manières de le concevoir.
Le philosophe Robert Solomon, qui défendait une vision aristotélicienne de l’éthique des affaires, propose un argument plus général, au sens où il concerne l’ensemble des vertus (6).
« Presque toutes les vertus d’Aristote peuvent être reconnues
comme vertus de la vie des affaires »
Parce que l’activité économique marchande est soumise à des contraintes spécifiques et qu’elle possède ses propres règles, on pourrait penser que les vertus des agents économiques sont, elles aussi, spécifiques. Solomon rejette cette idée car elle suppose une séparation entre l’activité économique et les autres activités humaines. Il défend au contraire la thèse d’une continuité qui va jusqu’à une harmonie entre les rôles professionnels et les autres rôles que chaque personne est appelée à jouer au cours de son existence. Il en résulte que, selon lui, « presque toutes les vertus d’Aristote peuvent être reconnues comme vertus de la vie des affaires », d’autant que « la vie des affaires est avant tout une activité sociale qui implique de traiter avec d’autres gens dans des situations à la fois stressantes et amicales ».
Solomon fait référence à la « modération » que défendait Aristote. Elle doit être comprise ici comme un principe gouvernant l’exercice de chacune des vertus, comme la recherche du « juste milieu » (7). Solomon l’applique à la vertu de générosité. Celle-ci, selon Aristote, n’exige pas que la personne sacrifie tous ses biens – une démarche que Salomon qualifie sans précaution de « fanatisme » (8) :
« Les vertus d’Aristote n’impliquent pas que nous nous comportions de façon radicale. De plus, le genre de fanatisme qui est loué, sinon prêché, par de nombreuses religions (« Abandonnez tous les biens de ce monde ») est totalement étranger à la ‘modération’ prônée par Aristote. Ainsi la personne généreuse ou ‘magnifique’ ne donne que la portion de richesse susceptible d’accroître son statut dans la communauté. On fait souvent ici le reproche bien connu selon lequel un tel don n’est pas véritablement généreux car il n’implique aucun sacrifice personnel et n’est motivé que par l’‘égoïsme’, par la quête de l’autoglorification. Mais Aristote refuserait d’admettre cette opposition entre l’intérêt personnel éclairé et la vertu. »
Dans un article publié en 2005, Geoff Moore aborde plus précisément la question de l’extension de la vertu de tempérance au-delà de la sphère de la personne (9). Il défend la possibilité qu’une organisation puisse être vertueuse, dans le sens où nous disons qu’une personne est vertueuse. Son argument s’adosse à la conception que propose Alasdair MacIntyre entre les biens internes et les biens externes relatifs à une pratique, que Moore appelle le « schéma vertus-pratiques-institutions » (10).
C’est l’un des rôles des entreprises d’équilibrer biens internes
(travail bien fait, belle œuvre) et biens externes (argent, réputation)
Selon ce « schéma », les vertus sont souvent exercées dans le cadre d’organisations dans lesquelles se déploient des métiers et des pratiques. Ces organisations sont censées favoriser un « travail bien fait », de faire en sorte que leurs membres produisent de belles œuvres, conformes aux idéaux de leurs métiers. Viser un travail bien fait, produire une belle œuvre, constituent ce que MacIntyre, reprenant une distinction d’Aristote, appelle un « bien interne ». Mais l’exercice d’un métier suppose aussi la recherche de biens externes, tels que l’argent, la réputation ou le rang social. Or, c’est l’un des rôles essentiels des organisations de trouver le juste équilibre entre biens internes et biens externes. Cette distinction simple éclaire les déviances morales imputées à des organisations et à des personnes : elles s’expliqueraient en effet par la recherche excessive, voire exclusive, de biens externes au détriment de biens internes. Les gains financiers ou la réputation prendraient le pas sur le travail bien fait.
Ce schéma permet à Moore d’identifier les vertus qu’une organisation devrait exercer afin de réaliser les biens internes qui reflètent sa raison d’être. La tempérance fait partie de ces vertus, à côté des autres vertus cardinales (force d’âme, justice et prudence), de l’intégrité et de la constance. La tempérance est en mesure de sortir des limites du moi et d’opérer au niveau d’une communauté d’individus, en l’occurrence d’une entreprise. Dans le passage qui suit, cet extension du domaine de la tempérance correspond à l’extension du rôle de l’entreprise dans la société :
« Pour qu’une entreprise soit vertueuse, des systèmes et des processus doivent être mis en œuvre. Ils garantissent que l’entreprise n’est pas ‘compartimentée’ par rapport aux autres institutions de la société, mais qu’elle se considère comme une partie d’un ensemble plus vaste. L’entreprise vertueuse devra également posséder et exercer les vertus, comprises en un sens collectif (corporate virtues), de tempérance – elle permet de résister à la tendance de toute entreprise à privilégier les biens externes – et de justice – qelle permet de mettre en balance ses propres intérêts (advantages) et ceux de la collectivité. C’est aussi et surtout la vertu de tempérance qui encourage une culture d’entreprise [susceptible de promouvoir la recherche de biens internes et l’équilibre de ces biens avec les biens externes]. »
3.
Différences et correspondances entre vertus personnelles et vertus sociales
En dépit de ces observations, il paraît étrange de vouloir appliquer la tempérance au-delà de la sphère personnelle. N’est-ce pas aller à l’encontre de la définition même d’une vertu, qui, parce qu’elle comprend des dimensions à la fois cognitives, motivationnelles et émotionnelles, semble ne pouvoir concerner que des individus (11) ?
Moore répond à cette objection en affirmant que l’entreprise peut avoir un caractère, à l’instar de tout être humain. On pourrait aussitôt lui rétorquer – même si cela ne rendrait pas justice à son travail – qu’il propose un argument ad hoc, c’est-à-dire conçu dans le but de justifier sa position sur l’extension des vertus. On pourrait surtout lui rappeler que les vertus morales sont souvent divisées en deux catégories : d’une part, les vertus personnelles, qui sont orientées vers le moi et qui contribuent au bien-être de la personne qui les exerce ; d’autre part, les vertus sociales, qui sont orientées vers autrui et qui contribuent au bien-être de la communauté à laquelle appartient la personne qui les exerce, voire à la société ou à l’humanité (12). Dans la première catégorie se trouvent par exemple la tempérance, la prudence, le courage et l’application au travail ; dans la seconde la justice, la générosité, l’honnêteté et la véracité.
La tempérance ne peut suffire à résoudre les crises environnementales
Dans un article relevant de l’éthique de l’environnement, Brian Treanor se fonde sur cette distinction pour affirmer que les vertus personnelles comme la tempérance ne peuvent suffire à résoudre les crises environnementales que l’humanité doit affronter, bien que beaucoup d’écologistes croient qu’elles devraient jouer un rôle de premier plan (13). Son argument vise le cadre eudémoniste, lié à l’épanouissement de l’individu, sur lequel reposent les vertus personnelles, et sur leur caractère « privé » et non « public » de ces vertus. Ce sont les « vertus publiques » qui devraient être promues en vue de réaliser le changement nécessaire à la préservation de l’environnement. Elles comprennent notamment la bienveillance envers les membres de sa communauté, l’attachement à la communauté, le souci de l’environnement local et l’engagement politique.
Même si Treanor souligne que la tempérance n’est pas reconnue comme une vertu très attractive dans un monde séduit par les comportements extravagants ou extrêmes, il lui accorde tout de même un rôle indirect :
« Dans la plupart des cas, la tempérance est une vertu personnelle car son objectif immédiat est l’épanouissement de l’individu. Les personnes tempérantes consomment ce qui leur est nécessaire et contribuent ainsi à leur bien-être puisqu’elles évitent les problèmes de santé associés à la gloutonnerie ou à un ascétisme excessif. Cependant, en ne consommant pas plus que ce qui est approprié, elles profitent également à leur communauté (locale et globale). Elles contribuent en effet à résoudre des problèmes collectifs tels que le réchauffement climatique, l’utilisation des sols et la pauvreté. »
Cette position rend nécessaire un approfondissement de la distinction entre vertus personnelles et vertus sociales. Il a notamment été proposé par Gabriele Taylor et Sybil Wolfram (14).
Ces auteurs réfutent la thèse selon laquelle la distinction entre vertus personnelles et vertus sociales est significative sur le plan moral. Partant de l’idée selon laquelle les vertus personnelles comme la tempérance contribuent au bien-être de la personne qui les exerce, tandis que les vertus sociales contribuent au bien-être d’autrui, ils observent qu’une « telle distinction implique qu’il importe d’exercer les vertus sociales et qu’en outre cet exercice revêt un caractère moral, alors que développer les vertus personnelles importe beaucoup moins et s’avère totalement intéressé ».
Selon Taylor et Wolfram, il est faux de penser que la différence entre les vertus personnelles et les vertus sociales vient de ce que les premières profitent à la personne alors que les secondes profitent à autrui. Cette différence se comprend mieux si l’on considère que les vertus personnelles sont liées au concept de force de caractère, tandis que les vertus sociales se définissent par le souci du bien d’autrui.
La référence aux concepts de raison d’agir et de croyance est importante dans la démonstration de Taylor et Wolfram. Leur nature diffère selon que la vertu est personnelle ou sociale.
Considérons la vertu sociale de générosité. Sa définition fait explicitement référence à autrui. En effet, une personne agit avec générosité si elle croit qu’une autre personne est dans le besoin et si cette croyance est la cause de son acte généreux.
La tempérance peut être exercée au bénéfice d’autrui
Ce n’est apparemment pas le cas de la vertu personnelle de tempérance, car les croyances de la personne tempérante ne semblent concerner qu’elle-même. En effet, la tempérance suppose que la personne croit qu’il existe une raison particulière de céder à la tentation (par exemple, boire de l’alcool avant de faire une conférence), alors qu’elle croit aussi que s’abstenir de ce type de plaisir (ne pas boire d’alcool avant de faire une conférence) est la raison principale qui devrait guider son action. La personne tempérante agit pour la raison principale et non la raison particulière, et sa capacité à résister à la tentation manifeste sa force de caractère.
Une telle définition suggère toutefois que la vertu de tempérance peut être exercée au bénéfice d’autrui. Car la croyance selon laquelle il faut s’abstenir d’un certain type de plaisir peut être justifiée de différentes manières. Elle peut recevoir une justification égoïste – boire de l’alcool avant de donner une conférence peut me faire perdre mes moyens, détériorer ma santé (et je tiens à ma santé), etc. – ou une justification orientée vers autrui – je dois donner l’exemple (d’autant que je suis une personne reconnue dans mon domaine), la consommation d’alcool encourage sa production (et je milite pour un encadrement strict de la vente d’alcool), etc. Autrement dit, le souci d’autrui peut faire partie des croyances qui fondent la vertu de tempérance.
D’autres arguments peuvent être avancés, fondés par exemple sur les normes sociales en matière de tempérance ou de modération, qui renvoient aux conditions du bien-être d’une société. Mais nous pouvons conclure notre exploration sur l’argument de Taylor et Wolfram. Il répond à la question de la possibilité de comprendre que la tempérance est, au moins dans certaines occasions, tournée vers le bien-être d’autrui.
Alain Anquetil
(1) T. Wells & J. Graafland, « Adam Smith’s bourgeois virtues in competition », Business Ethics Quarterly, 22(2), 2012, p. 319-350
(2) Aristote, Ethique à Nicomaque, tr. J. Tricot, Paris, Vrin, 1990. Voir la note 3 de notre article précédent, dans laquelle nous indiquions que nous ignorons la distinction d’Aristote entre la sophrosunê (la modération dans les désirs) et l’enkratéia (la maîtrise de soi), qu’emploie Aristote dans son Ethique à Nicomaque. La tempérance dont nous parlons ici correspond à l’enkratéia.
(3) I. Murdoch, The sovereignty of good, Londres, Chatto et Windus, 1970, tr. C. Pichevin, La souveraineté du bien, Combas, L’éclat, 1994. Le passage est le suivant : « Le monde est dépourvu de finalité, contingent et infiniment grand ; nous sommes aveuglés par le moi ».
(4) C. Chan & S. Ananthram, « Religion-based decision making in indian multinationals: A multi-faith study of ethical virtues and mindsets », Journal of Business Ethics, 156, 2019, p. 651-677.
(5) P. Sanz & J. Fontrodona, « Moderation as a moral competence: Integrating perspectives for a better understanding of temperance in the workplace », Journal of Business Ethics, 155, 2019, p. 981-994. Nous avons discuté de leur article dans les troisième et quatrième sections de notre précédent article.
(6) R. C. Solomon, « Corporate roles, personal virtues: An Aristotelean approach to business ethics », Business Ethics Quarterly, 2(3), 1992, p. 317-339, tr. C. Laugier, « Rôles professionnels, vertus personnelles : une approche aristotélicienne de l’éthique des affaires », in A. Anquetil (dir.), Textes clés de l’éthique des affaires, Paris, Vrin, 2011.
(7) Voir mon article précédent. Roger Crisp observe que « la doctrine d’Aristote n’est donc pas celle de la modération. Parfois, par exemple, on sera amené à être très en colère, et parfois à ne donner qu’une toute petite somme d’argent. Cela dépend des circonstances, et la modération n’a rien à dire en soi » (R. Crisp, « Introduction », Aristotle, Nicomachean Ethics, tr. et dir. Roger Crisp, Cambridge University press, 2004).
(8) Il faut le comprendre au sens de « comportement, état d’esprit de celui qui se croit inspiré par la Divinité » (CNRTL).
(9) G. Moore, «Corporate character: Modern virtue ethics and the virtuous corporation », Business Ethics Quarterly, 15(4), 2005, p. 659-685.
(10) A. MacIntyre, After virtue, Notre Dame, Notre Dame University Press, 1984. tr. L. Bury, Après la vertu, Paris, PUF, 1997. Pour un exemple d’application, on peut se référer à mon article « La poursuite des biens internes expliquerait l’amour du public pour le Tour de France » du 30 juillet 2018.
(11) Voir l’article « La place de la vertu de tempérance dans l’éthique des affaires ».
(12) « En gros, la distinction traditionnelle est la suivante : un homme possédant les vertus orientées vers autrui fera du bien (benefit) aux autres, tandis qu’un homme qui possède les vertus personnelles fera surtout du bien à lui-même » (G. Taylor & S. Wolfram, “The self-regarding and other-regarding virtues”, The Philosophical Quarterly, 18(72), 1968, p. 238-248).
(13) B. Treanor, « Environmentalism and public virtue », Journal of Agricultural & Environmental Ethics, 23, 2010, p. 9-28.
(14) G. Taylor & S. Wolfram, op. cit.