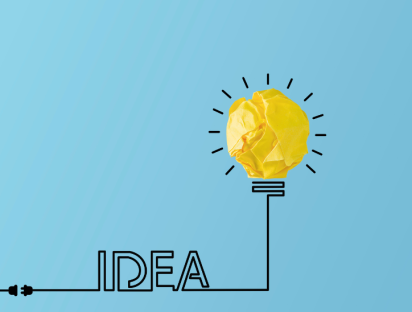Dans le précédent article, la doctrine de la non-violence était invoquée dans le but de porter une appréciation sur l’importance morale du langage de la violence qui a été utilisé dans le cadre du débat public sur le projet de loi travail. Qu’il s’agisse de sa partie stratégique et tactique, comme méthode de lutte et de résistance, ou de sa partie éthique, où elle fournit des prescriptions sur la manière de conduire une existence humaine, la doctrine de la non-violence offre des critères qui permettent d’orienter la délibération et l’action. On s’attend à ce que l’éthique des affaires, une branche de l’éthique appliquée donc la finalité est tournée vers la délibération et l’action des praticiens, se réfère ou s’inspire de la doctrine de la non-violence. C’est en effet le cas, mais le nombre de travaux est plutôt réduit. J’ai identifié cinq articles notables, tous publiés entre 2009 et 2014 dans le Journal of Business Ethics (1). J’en rends compte sous un angle descriptif et parfois critique – à la fois, pour des raisons de place, dans cet article et dans l’article suivant.
Dans aucun des articles en question la doctrine de la non-violence n’est examinée en tant que telle. Elle est, ce qui est logique, placée dans le contexte des philosophies de l’Inde. C’est l’une des raisons pour lesquelles leurs auteurs s’efforcent de décrire les concepts avant d’expliquer la manière dont ils peuvent trouver une traduction dans le management de l’entreprise ou les relations d’affaires. En voici deux exemples.
Dans son article, Patricia Doyle Corner décrit la tradition spirituelle du yoga dont l’un des principes est, selon ses termes, « d’harmoniser les interactions avec l’environnement externe puis d’approfondir l’environnement intérieur pour développer la conscience humaine » (2). Elle décrit les cinq yamas ou réfrènements qui gouvernent les relations de la personne avec son environnement en « approfondissant [sa] compréhension de l’effet de ses propres actions sur ses relations sociales au sein de n’importe quelle communauté ».
Le premier de ces yamas est la non-violence, traduction courante du mot ahimsâ qui, toujours selon les termes de Corner, « conduit la personne à ne former aucune intention de nuire dans le cadre de ses actions, [et prescrit] l’absence d’hostilité envers autrui et l’amour des autres pour le potentiel qui est en eux ». Corner signale la difficulté d’une telle prescription, notant que si « le but ultime est d’éliminer la violence de notre nature, […] cela peut nécessiter des années de pratique ». Elle ajoute cependant que « pratiquer l’ahimsâ, même à une petite échelle, permet à la personne de commencer à rompre le cercle vicieux et à créer des interactions sociales harmonieuses dans son environnement ».
Après avoir rapproché l’ahimsâ de concepts voisins qui ont été proposés en particulier dans la littérature sur les valeurs ou la spiritualité dans le monde professionnel (par exemple le souci d’autrui et la bienveillance), elle insiste sur le fait que « l’ahimsâ peut être appliquée sur le lieu de travail ». En pratique, la non-violence conduit un employé à « respecter les valeurs culturelles et religieuses de ses collègues », à « éviter toute discrimination fondée sur le genre, l’âge, les préférences sexuelles, le handicap, l’origine éthnique, la culture, la religion ou les convictions politiques », et à « préserver la confidentialité des informations sensibles sur ses collègues, qu’elles aient une forme verbale ou écrite ».
Corner évoque le possible conflit entre l’ahimsâ et un autre yama, satya, qui désigne la sincérité, la véracité, par exemple lorsqu’un employé est confronté à l’obligation de dire la vérité sur un collègue. À la fin de l’article, elle propose, sans le développer en détail, un schéma intégratif où les cinq yamas sont reliés à l’éthique sur le lieu de travail. Enfin elle formule une série de propositions relatives à l’éthique de l’entreprise, des propositions qui lui paraissent testables empiriquement, dont les deux suivantes concernent l’ahimsâ :
« Les entreprises dont les employés pratiquent l’ahimsâ reçoivent moins de doléances que celles au sein desquelles l’ahimsâ est absente (à cause de liens plus étroits entre collègues). »
« Les environnements professionnels où les employés pratiquent l’ahimsâ connaissent moins de cas d’alcoolisme ou d’autres cas d’addictions que ceux où ce yama n’est pas pratiqué (à cause d’une plus grande conscience de soi et parce que les individus sont « non-violents » envers eux-mêmes). »
De leur côté, Niranjan Narasimhan, Kumar Bhaskar et Srinivas Prakhya proposent un « système de valeurs personnelles inspiré des textes anciens de l’Inde, en l’occurrence les textes épiques hindous du Mahabharatha et du Ramayana. Ce qui les intéresse, ce sont les croyances fondamentales et les valeurs qui y sont développées.
Après avoir rappelé quelques définitions générales, issues de la littérature occidentale, du concept de valeur, ils soulignent que toute valeur influence la conduite d’une personne, que cette valeur soit ou non reconnue et prescrite par la société. Ils proposent une synthèse des approches de ce concept en psychologie sociale et en philosophie, résumant à grands traits la question de l’essence de la nature humaine à travers la position existentialiste.
Pour aborder le concept de valeur dans la philosophie indienne, ils accordent une importance particulière au concept de croyance, celle-ci ayant pour objet « la réalité ultime et le moi ». Ils décrivent deux types de croyances : les croyances existentielles et les croyances prescriptives (qui correspondent aux valeurs), en s’attachant à formuler dix énoncés de croyances « extraits » (selon leur mot) des textes épiques qu’ils ont présentés. Ces énoncés sont les composantes du « système de valeurs personnelles » qui constitue l’objet de leur étude. En voici quatre exemples :
Je crois en un pouvoir surnaturel / dieu / l’esprit / le moi.
Je crois en la loi de l’action et de la réaction. (4)
Lorsque j’agis, j’ai à l’esprit les conséquences de mes actions.
J’accorde autant d’importance aux moyens qu’aux fins.
Les auteurs ont testé la validité et la cohérence de cet ensemble d’énoncés dans le cadre d’une enquête réalisée auprès de 20 entreprises indiennes. Ils ont exploité 698 réponses d’employés à un questionnaire relatif « aux valeurs personnelles et professionnelles, à la culture de l’entreprise et à la perception des valeurs des dirigeants ». Les répondants utilisaient une échelle de 1 (je désapprouve fortement) à 5 (j’approuve fortement). (Malheureusement le questionnaire n’est pas joint à l’article, et l’on peut regretter que l’articulation entre les questions y figurant et les 10 énoncés de croyances et de valeurs « extraits » du Mahabharatha et du Ramayana n’aient pas été explicités.) Les résultats (qui, eux non plus, n’ont pas été précisément décrits) ont, selon les auteurs, confirmé la cohérence du système de valeur personnelles qu’ils ont dérivé de ces textes fondamentaux.
Quelle est, dans le cadre de cette recherche, la place de la non-violence (ahimsâ) ? On la trouve évoquée dans la discussion des résultats. Les auteurs y précisent que le système de valeurs qu’ils ont proposé devrait prendre en compte les désirs matériels qu’éprouvent les êtres humains, dont ceux visant la prospérité, dès lors que leurs valeurs permettent également de les transcender. Ils décrivent quatre valeurs dont la fonction est de guider leur conduite « tout en reconnaissant explicitement la dualité entre l’individu et le monde ». Ils soulignent que « le désir pour des objets matériels est acceptable et que leur acquisition est permise si le dharma [que les auteurs, après l’avoir défini comme « la nature innée ou caractéristique de toute entité dans l’univers – par exemple, le dharma du feu est de brûler » – résument ici par « l’action juste »] n’est pas violé ».
C’est ici qu’intervient l’ahimsâ, qui, bien qu’elle soit une composante du dharma, devrait, selon les auteurs, être reconnue comme une valeur en tant que telle. Ils affirment ainsi que « la possession des objets désirés est légitime à condition que les principes de l’action juste et de la non-violence ne soient pas violés à travers le processus d’acquisition ».
Hélas, Narasimhan, Bhaskar et Prakhya n’en disent pas plus sur la mise en pratique de l’ahimsâ (ni, soit dit en passant, sur le fait de savoir si le questionnaire comprenait au moins une question sur la non-violence), si bien que, malgré les informations qui sont délivrées dans l’article, le lecteur reste sur sa faim. Ce n’était pas le cas pour l’article plutôt suggestif de Corner, et ce ne sera pas le cas pour les articles qui seront résumés dans le prochain article.
Alain Anquetil
(1) Les deux autres revues majeures du domaine, Business Ethics Quarterly et Business Ethics: A European Review, n’y font, sauf erreur de ma part, aucune référence. Dans le Journal of Business Ethics, un sixième texte mentionne l’ahimsâ, mais le concept n’y est pas développé (K. Pavlovich et P. D. Corner, « Conscious enterprise emergence: Shared value creation through expanded conscious awareness », Journal of Business Ethics, 121, 2014, p. 341-351).
(2) P. D. Corner, « Workplace spirituality and business ethics: Insights from an Eastern spiritual tradition », Journal of Business Ethics, 85, 2009, p. 377-389.
(3) N. Narasimhan, K. Bhaskar et S. Prakhya, « Existential beliefs and values », Journal of Business Ethics, 96, 2010, p. 369-382.
(4) Voir la description de la « loi du karma » proposée sur le site Brahlakumaris.org.
[cite]