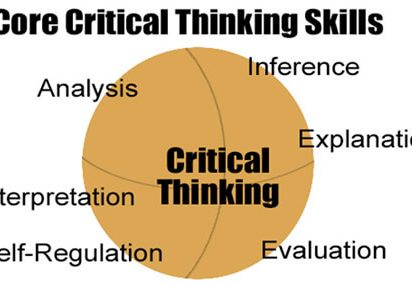Les burakumin ont fait l’objet d’un reportage au journal télévisé d’Arte le 13 juin 2011. Le mot désigne une « caste invisible » japonaise constituée de personnes rejetées de la société – des parias qui « occupaient traditionnellement des métiers liés à la mort », comme le précise le reportage. Certain
Un responsable de Tepco, interviewé par Arte, déclarait : « Notre société compte aujourd’hui 300 employés à Fukushima. Les autres proviennent de compagnies qui collaborent avec nous. Elles-mêmes sous-traitent à d’autres compagnies. Résultat : nous ne savons pas qui, et quelles conditions de travail ces compagnies proposent aux employés, surtout sur les tâches dangereuses ». Et dans un article publié en avril 2011, Rue89 précisait que « les yakuza (mafia) (…) embauchent ces hommes qui vivent dans une grande précarité (la plupart sont sans-abri) pour des salaires d’environ 10 000 yens par jour, leur confient les tâches les plus ingrates et les plus exposées aux rayons ionisants, puis les relâchent dans leur infortune initiale [je mets en italiques]. S’ils développent un cancer, c’est ni vu ni connu : cela n’apparaîtra pas dans les statistiques ».
Supposons que ces hypothèses soient potentiellement valides et, plus largement – c’est-à-dire en dehors du contexte de Fukushima –, que les burakumin puissent effectivement être employés dans de telles conditions. Supposons aussi qu’une entreprise qui serait susceptible de les employer ait le souci sincère de se conduire de manière éthique. Supposons enfin que cette entreprise s’interroge sur les obligations morales qu’elle aurait envers les burakumin. Comment réfléchirait-elle à la question ?
Elle pourrait s’inspirer d’un cadre théorique bien connu de l’éthique des affaires : la théorie des parties prenantes. Au sein de la vaste littérature qui y a été consacrée depuis plus de 20 ans, on trouve des réflexions sur la nature des obligations dues par l’entreprise à ses parties prenantes. Des travaux ont porté en particulier sur la légitimité de tous ceux, groupes ou individus, qui sont susceptibles d’affecter ou d’être affectés par les activités de l’entreprise (pour reprendre la définition large des parties prenantes proposée il y a longtemps par Freeman). Si telle entité, groupe ou individu, est considérée comme une partie prenante, c’est qu’elle est légitime. Il n’est donc pas étonnant que le concept de légitimité lui-même ait fait l’objet d’une attention particulière.
La légitimité est un « attribut » de la relation entre l’entreprise et ses parties prenantes (1). Ce point est souligné par Phillips dans un article consacré à ce concept (2). Il rappelle que les obligations morales d’une firme envers ses parties prenantes ne sont pas celles qui sont dues fondamentalement à autrui en vertu du fait qu’autrui est une personne. Ce sont des obligations additionnelles qui trouvent leur origine dans la relation particulière qu’entretiennent la firme et les autres participants à un schéma de coopération volontaire. Elles dépendent étroitement de ce schéma particulier. Phillips précise qu’il s’agit d’obligations d’équité et que « seuls les groupes envers lesquels s’applique une obligation d’équité sont des parties prenantes ». La légitimité de ces dernières est une légitimité intrinsèquement morale.
Il précise aussi que cette conception fondée sur la coopération implique par exemple que la violation, par une entreprise, de droits humains, ou son absence de souci pour la préservation de l’environnement naturel, sont des actes « moralement condamnables indépendamment du fait de savoir si les victimes sont ou non des parties prenantes ». S’ils sont condamnables, c’est parce qu’ils violent des obligations morales fondamentales, pas les obligations morales additionnelles dues aux parties prenantes. Cela réduit de fait la portée de la théorie des parties prenantes, qui ne devrait pas être conçue pour « prendre en compte toute la misère du monde » (3).
Revenons maintenant au cas des burakamin et à la réflexion que mènerait une firme éthique sur les obligations qu’elle aurait envers eux si elle venait à les employer. Dans la mesure où ils participeraient à un schéma de coopération (celui consistant par exemple à travailler dans une centrale nucléaire en vue d’une certaine fin), la firme aurait à leur égard une obligation morale additionnelle d’équité. Par exemple, le principe d’équité s’appliquerait à la rémunération de leur travail (leur contribution au schéma de coopération) et à la considération qui leur serait accordée (ils seraient considérés comme des égaux, non comme des personnes appartenant à un groupe social potentiellement discriminé).
Toutefois, dans un cas tel que celui des burakumin, un problème particulier se pose en cas de fin de la relation d’emploi. Une remarque de l’article de Rue89 l’exprime crûment : « puis les relâchent dans leur infortune initiale ». Elle signifie qu’après avoir eu recours à leurs services, une firme pourrait les renvoyer dans leur condition initiale, celle qui prévalait avant leur emploi alors qu’ils vivaient en marge de la société.
Il est possible de défendre l’idée que, dans ce cas, l’entreprise a une obligation spéciale visant à éviter que des employés ne retrouvent leur « infortune initiale ». Par exemple, lors d’une rupture de la relation d’emploi, elle pourrait mettre en place une politique spéciale permettant à ses anciens employés appartenant à un groupe socialement marginalisé de conserver la position d’égalité dont ils jouissaient lorsqu’ils étaient membres de la firme.
Comment justifier une telle obligation ? Plusieurs réponses sont possibles. La première relève de la responsabilité sociale de l’entreprise. Les politiques envers les groupes défavorisés ou celles visant à établir une égalité des opportunités sont du ressort des pouvoirs publics. Mais les firmes peuvent y contribuer dans le cadre de leur responsabilité sociale, comme elles le font aujourd’hui par exemple à travers des initiatives favorisant la diversité. Cela revient à apporter une justification externe à une obligation spéciale envers les membres de groupes mis en marge de la société.
Mais il est également possible d’apporter des justifications internes. L’une d’elles, d’inspiration kantienne, fait appel au souci que les employés dont la firme se sépare conservent une existence pleinement autonome.
Une autre repose sur l’idée qu’une entreprise est une communauté morale qui ne s’étend pas seulement aux employés actuels de l’entreprise, mais aussi à ses anciens membres. Cette idée n’est pas si étrange et elle n’est pas fondée uniquement sur le souci de sa réputation. Après tout, pour reprendre les termes de Phillips, les salariés qui participent à un schéma de coopération sont destinés à quitter leur entreprise d’une manière ou d’une autre. Ils peuvent donc attendre aujourd’hui qu’elle anticipe ce moment et prévoie de les traiter, eu égard à leur situation future, de façon équitable. Leur engagement dans la coopération peut dépendre du respect de ces obligations spéciales envers le futur. Pour les membres de groupes défavorisés comme les burakumin, cela signifie que leur entreprise devrait garantir qu’ils puissent conserver, après leur départ, un statut d’égalité dans la société. Mais hélas ! c’est une justification moralement contraignante et qui présente aussi un caractère contre-productif.
Alain Anquetil
(1) « Beaucoup de chercheurs emploient le terme “légitimité”, mais peu le définissent », écrivait Suchman dans un article souvent cité. Sa propre définition va au-delà de « la congruence entre l’organisation et la culture qui constitue son environnement ». Elle recouvre plutôt « la perception ou l’hypothèse, de portée générale, selon laquelle les actions d’une entité sont désirables, convenables ou appropriées au sein d’un système social de normes, de valeurs, de croyances et de définitions ». M. C. Suchman, « Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches », Academy of Management Review, 20(3), 1995, p. 571-610.
(2) R. Phillips, « Stakeholder legitimacy », Business Ethics Quarterly, 13(1), 2003, p. 25-41.
(3) Clarkson, cité par Phillips. M. B. E. Clarkson, A Risk-Based Model of Stakeholder Theory, Toronto, The Centre for Corporate Social Performance & Ethics, 1994.