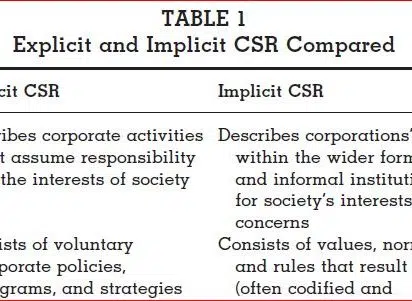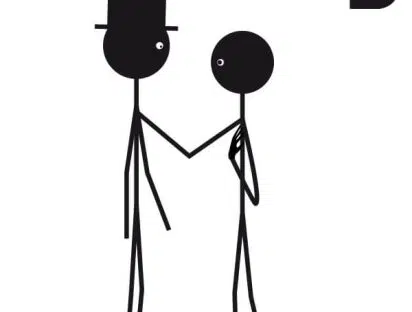Il va de soi que les théories issues de l’éthique normative, qui constitue l’une des trois branches de la philosophie morale, ont été « appliquées » aux situations de faillite. Dans son ouvrage Ethics of bankruptcy, le philosophe et spécialiste de l’éthique des affaires Jukka Kilpi propose une analyse serrée des questions morales posées par la faillite. Il considère les approches normatives classiques du déontologisme, de l’utilitarisme et de l’éthique de la vertu, en insistant plus particulièrement sur la manière dont le déontologisme kantien inspire la réflexion dans ce domaine. Moins que le problème de coordination posé par les situations de défaillances d’entreprises, c’est la situation morale du débiteur, le failli, qui constitue son objet d’étude. Dans ce billet, c’est le débiteur en tant que personne physique (le failli) qui concentrera notre attention, ainsi que l’approche déontologique.
Si un débiteur doit payer ses dettes, ce n’est pas parce que la loi l’impose, mais en raison des contrats qui le lient à ses créanciers. Ce contrat est une forme de promesse ou il formalise une promesse. Kilpi souligne ainsi que, d’un point de vue moral, la faillite peut apparaître comme la rupture d’une promesse. Or, si tel est le cas, « l’autonomie de celui qui promet implique un devoir prima facie [ou à première vue] de tenir ses promesses ».
Le point important est que le devoir de tenir une promesse, ici la promesse consistant à rembourser ses dettes, est un devoir prima facie et non absolu, ce en raison du principe devoir implique pouvoir ou « à l’impossible nul n’est tenu ». L’obligation de tenir ses promesses, dit Kilpi, « est en fait un devoir prima facie [car] dans certaines circonstances cette obligation est invalide même si l’autre partie, celle qui bénéficie de la promesse, veut que nous la tenions. Je ne parle pas seulement des circonstances dans lesquelles il est impossible d’accomplir l’acte requis. Nous n’avons aucune obligation, même à première vue, d’accomplir des actes impossibles, parce qu’un devoir qui conduirait à accomplir un acte qui ne peut pas l’être serait par essence contradictoire. [Ainsi], la position de celui qui promet peut évoluer au cours du temps de telle sorte que les caractéristiques nécessaires de l’engagement moral propre à la promesse ne sont plus présentes. »
Cette position peut être formulée sous la forme d’un argument déontologique en faveur de la protection du débiteur. Il repose sur la valeur intrinsèque de l’autonomie du débiteur qui est typique d’une éthique kantienne. Si l’on applique cette perspective aux situations de faillite, il en résulte qu’un endettement contraindrait de façon radicale la liberté du débiteur, sa capacité à faire des choix autonomes comme un agent authentiquement libre.
Kilpi souligne que la perspective du déontologisme kantien rend illégitime toute loi qui contraindrait un débiteur à rembourser ses dettes jusqu’à la fin de ses jours. La « servitude pour dettes », qui est un type d’esclavage, est d’ailleurs condamnée par la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage qui a été signée à Genève le 7 septembre 1956.
Kilpi résume ainsi l’argument inspiré du déontologisme kantien :
« Un endettement perpétuel impliquerait un contrôle de la vie de la personne insolvable d’une manière telle que ce contrôle étendrait de facto les droits des créanciers à la personne du débiteur. Cela reviendrait à réduire le débiteur à un pur moyen de satisfaire les intérêts des créanciers. Comme Kant l’a noté, les droits naturels d’une personne disparaissent s’il n’est rien d’autre qu’un débiteur. La solution est d’accorder au débiteur une réduction de ses dettes. Celle-ci peut être considérée comme l’expression du principe kantien selon lequel on doit traiter les personnes comme des fins. »
Cette position ne signifie pas que le débiteur est exonéré de tout jugement de blâme. S’il a eu un comportement malhonnête en tant que dirigeant, non seulement il fera l’objet d’un jugement moral de désapprobation, mais il sera poursuivi en justice pour les actes qu’il a accomplis. Qu’en est-il du failli qui, sans être ni malhonnête ni insensible, a fait preuve d’un manque de jugement ou d’un défaut d’intelligence pratique ayant eu pour conséquence la défaillance de son entreprise ? Kilpi considère qu’un tel débiteur fait également l’objet d’un jugement de blâme :
« Les jugements relatifs aux décisions de gestion (business judgements) sont moralement négatifs si l’on peut affirmer de façon raisonnable que l’on aurait pu faire mieux. Si, en tant que débiteur et afin de respecter mes engagements, j’utilise mes compétences à un degré moindre que ce dont je suis capable, et si ce fait a des conséquences négatives sur autrui, on est tenté de dire que j’ai mal agi d’un point de vue moral parce que j’ai été négligent ou paresseux. Mais si j’ai l’intention d’agir aussi bien que possible et si je fais de réels efforts pour y parvenir, il est vain d’affirmer que j’ai mal agi sur le plan moral parce je n’ai pas réussi. »
Cet argument est typiquement moral et non légal, même si les distinctions légales peuvent s’inspirer des distinctions morales. Comme le remarque Kilpi, les critères consistant à évaluer la capacité à agir conformément à ses capacités, plus précisément à ses compétences, et à faire tous les efforts nécessaires pour payer ses dettes, ont une dimension subjective qui est, semble-t-il, irrévocable, surtout dans le premier cas.
En effet, le premier critère, celui des compétences, est par nature difficile à évaluer. On peut bien sûr imaginer une situation dans laquelle un dirigeant ne parvient pas à mobiliser ses compétences pour des raisons particulières, par exemple sentimentales, ce qui revient à introduire un élément subjectif dans la situation, mais alors on le blâmera pour cela ou pour un défaut de maîtrise de soi ou encore pour un manque d’esprit de responsabilité.
Quant au deuxième critère, il a un sens moins subjectif (pensons à un dirigeant qui s’épuise à rechercher des solutions aux difficultés de son entreprise), mais son évaluation est aussi sujette à caution : que sont en effet les « réels efforts » auxquels les efforts du dirigeant devraient être comparés ? Si l’on répond qu’il s’agit des « réels efforts » qu’aurait consentis tout dirigeant raisonnable, on ne fait que repousser le problème.
Malgré ces objections, il n’en demeure pas moins que, comme le remarque Kilpi, « l’éthique de la faillite a retenu le principe selon lequel une personne insolvable ne devrait pas être sanctionnée si ses efforts pour rembourser ses dettes ont été authentiques. » Ce qui semble suggérer que les intuitions morales relatives à la faillite dépendent à un certain degré d’intuitions morales relatives à la responsabilité personnelle du failli.
Alain Anquetil
(1) J. Kilpi, The ethics of bankruptcy, Routledge, 1998.