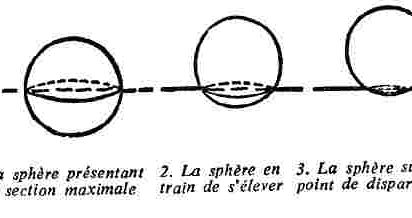C’est un article de la revue scientifique JAMA Internal Medicine du 12 septembre dernier (1), accompagné d’un article du New York Times paru le même jour, qui ont mis cette affaire dans l’espace public. Plusieurs médias y ont fait référence dans les jours suivants, notamment Le Temps, France Culture, La Tribune et Courrier International. Pourtant, l’affaire n’est pas vraiment nouvelle. Arte y avait consacré un documentaire en 2015 (« Sucre, le doux mensonge »), dont la présentation résumait déjà le problème : « Des décennies durant, l’industrie sucrière a réussi à nous tromper en vantant les prétendus mérites de ses produits. Pas un mot sur les risques sanitaires liés à une consommation excessive de sucre. Et des mensonges qui ont un goût amer pour de nombreux consommateurs, niant le surpoids, le diabète et les maladies cardio-vasculaires. »
Qu’ajoutent l’article de la revue JAMA Internal Medicine et du New York Times ? La révélation qu’une organisation issue de l’industrie du sucre, la Sugar Research Foundation, avait, dans les années 1960, rémunéré des scientifiques de l’université Harvard pour minimiser le rôle de la consommation de sucre dans les maladies cardio-vasculaires. Les travaux de deux chercheurs, publiés en 1967 dans le New England Journal of Medicine, concluaient que les acides gras saturés aggravaient les risques d’apparition de ces maladies, la dernière phrase de l’article signalant qu’en revanche, les glucides (les « carbohydrates ») avaient une contribution très inférieure au même risque (2). Pour les commentateurs, cet effet rhétorique a paru typique d’une méthode habile de persuasion que le philosophe Blaise Pascal (1623-1662) a décrite et conceptualisée dans ses notes réunies dans Les pensées (1669-1670) et dans son traité L’Art de persuader (1658). Les magazines Quartz et Slate, ainsi que France Culture, ont réfléchi sous cet angle au mensonge de l’industrie sucrière américaine.
Plutôt que l’angle de la persuasion, c’est celui de la typification qui m’a intéressé. J’en explique les raisons dans le présent article.
La méthode de persuasion utilisée par l’industrie sucrière est résumée par France Culture : « […] Sans nier les risques liés aux maladies cardio-vasculaires, l’industrie a réussi le tour de force de faire dérailler la discussion à propos du sucre. Comment ? En se contentant de minimiser le rôle du sucre dans ces pathologies, tout en incriminant à sa place le rôle du gras. » Il ne s’agit pas, pour ceux qui cherchent à persuader, de contredire la personne visée, mais de reconnaître devant elle que ce qu’elle croit est vrai sous un aspect, puis de lui faire comprendre que la vérité qu’elle croit posséder est incomplète (3). Dans le cas du sucre, la méthode aurait consisté à mettre l’accent sur un autre aspect de la vérité relative aux maladies cardio-vasculaires – l’effet nocif des graisses saturées – en créant un contraste avec l’effet des glucides, présenté comme peu significatif.
Cette analyse ne manque pas d’intérêt, mais c’est une autre chose, presque un détail, qui a retenu mon attention. Le détail se trouve dans cette phrase de l’article du New York Times du 12 septembre, qui a été prononcée par l’un des trois auteurs de l’article de la revue JAMA Internal Medicine : « They were able to derail the discussion about sugar for decades », c’est-à-dire : « Ils ont été capables de détourner la discussion sur le sucre pendant des décennies » – ce que France Culture traduit par : « L’industrie a réussi le tour de force de faire dérailler la discussion à propos du sucre ». Le premier mot clé est ici « able », qui prend deux sens possibles : avoir la capacité, par exemple le pouvoir, de faire quelque chose ; ou avoir la liberté, c’est-à-dire ne pas être empêché, de faire quelque chose (4). Les deux sens pourraient être invoqués dans le cas d’espèce.
Pourquoi le mot clé de cette affaire de mensonge et de connivence (Le Temps parle de « trafic d’influence ») serait-il le banal adjectif « able » ? Parce que cet adjectif rend compte, sur le plan du caractère, de ce que des personnes, en l’occurrence des représentants d’un secteur industriel, ont été capables de faire. Analyser la méthode de persuasion qu’ils ont utilisée est une chose intéressante, mais se demander comment des personnes ont pu avoir l’intention (avec préméditation, c’est-à-dire avec le « dessein réfléchi de commettre une action, surtout mauvaise ») de mentir est, me semble-t-il, une question plus intéressante encore.
Cette question peut être formulée en termes de « type de personne ». Un type est ici une forme de caractère (au sens psychologique) dont on peut dériver, par déduction, des manières d’agir face à des situations. Dans la psychologie, en particulier la psychologie sociale et la psychologie cognitive, le mot « type » apparaît surtout au sein des mots « prototype » et « typicalité ». On le trouve associé aux processus de catégorisation qui nous permettent d’interpréter les situations auxquelles nous sommes confrontées. L’une des références bien connues est la perspective de la psychologue américaine Eleanor Rosch, qu’elle a exposée à la fin du siècle dernier, en particulier dans les années 1970 (5). Un aspect de sa théorie est qu’au sein d’une classe d’objets, i.e. d’une catégorie (6), les objets ont une ressemblance plus ou moins grande, c’est-à-dire qu’ils « peuvent être situés sur un gradient de typicalité », comme le dit la psychologue Danièle Dubois. Elle précise que « certains exemplaires […] sont jugés très représentatifs de la catégorie », d’autres moins (7). La perspective de Rosch inclut également l’idée qu’il existe des « niveaux de catégorisation privilégiés », appelé « niveaux de base » (7). Par exemple, une personne n’ayant pas les connaissances d’un ornithologiste utilisera le niveau de base « oiseau » pour classer tel animal, alors qu’un ornithologiste pourra utiliser un niveau différent, situé plus bas dans la hiérarchie (8). S’inspirant toujours de Rosch, la philosophe Cristina Bicchieri précise que « la préférence pour un niveau de base de catégorisation semble fondée sur le besoin de maximiser le potentiel inférentiel et prédictif [de la catégorisation] » (9).
Ce à quoi le « able » de la phrase « Ils ont été capables (able) de détourner la discussion sur le sucre pendant des décennies » conduit, c’est à une typification, un « processus par lequel on perçoit le monde et on le structure à l’aide de types catégoriques » (10). Il conduit, dans le cas qui nous intéresse, à la construction d’un type de personne, à peu près le type du manipulateur qui planifie son mensonge sans égards pour l’intérêt général. La « puissance typificatrice » dont les êtres humains sont capables, ainsi que le « potentiel inférentiel et prédictif » de ce qui est catégorisé et nommé, ont, dans l’affaire du mensonge de l’industrie sucrière, un intérêt au moins aussi grand que la méthode de persuasion utilisée. L’écrivain allemand Ernst Jünger, auquel j’ai emprunté l’expression « puissance typificatrice » (11), rappelle que la dénomination reste une dénomination, qu’elle appartient à l’ordre humain des représentations, pas à l’ordre de la nature, qu’elle est artificielle et n’a rien d’une essence. « Cette vérité toute simple, les descriptions la dissimulent sous des écrans de papier », écrivait-il. Mais il corrigeait aussitôt, rappelant qu’« il ne faut pas voir là une réfutation des noms. Les noms sont forts et peuvent servir, surtout pour qui sait ‘qu’au bout du compte’, ils ne tiennent pas. » Manifestement, le type dénommé « manipulateur qui planifie son mensonge sans égards pour l’intérêt général » n’a pas été considéré pour analyser l’affaire de l’industrie sucrière. C’est, somme toute, un fait assez notable.
Alain Anquetil
(1) « Sugar industry and coronary heart disease research. A historical analysis of internal industry documents » (« L’industrie sucrière et la recherche en matière de cardiopathies coronariennes. Une analyse historique de documents internes à l’industrie ».
(2) « Dietary fats, carbohydrates and atherosclerotic vascular disease », consultable en ligne sur le College of Natural Resources de l’université de Berkeley.
(3) Ce fragment de Pascal est cité par le magazine Slate : « Quand on veut reprendre avec utilité et montrer à un autre qu’il se trompe, il faut observer par quel côté il envisage la chose, car elle est vraie ordinairement de ce côté-là et lui avouer cette vérité, mais lui découvrir le côté par où elle est fausse. Il se contente de cela car il voit qu’il ne se trompait pas et qu’il y manquait seulement à voir tous les côtés. Or, on ne se fâche pas de ne pas tout voir, mais on ne veut pas être trompé, et peut-être cela vient de ce que naturellement l’homme ne peut tout voir, et de ce que naturellement, il ne se peut tromper dans le côté qu’il envisage, comme les appréhensions des sens sont toujours vraies. » (Pensées, fragment 9 édition Brunschvicg, 701 édition Lafuma).
(4) Je m’inspire ici du dictionnaire Merriam-Webster.
(5) Voir E. Rosch et B. Lloyd (dir.). Cognition and categorization, Lawrence Erlbaum Associates, 1978.
(6) Selon Rosch, et comme le résume Danièle Dubois, une catégorie est « un ensemble d’objets qui sont considérés comme équivalents, et généralement désignés par un nom » (in D. Dubois (dir.), Sémantique et cognition. Catégories, prototypes, typicalité, Editions du CNRS, 1991).
(7) D. Dubois (dir.), op. cit.
(8) Je me réfère ici à Cristina Bicchieri, The grammar of society:The nature and dynamics of social norms, Cambridge University Press, 2006.
(9) C. Bicchieri, op. cit.
(10) J. C. McKinney, « Typification, Typology, and Sociological Theories », Social Forces, 48(1), 1969, p. 1-12.
(11) Dans E. Jünger, Typus, Name, Gestalt, 1981, tr. fr. F. Poncet, Type, nom, figure, Christian Bourgois Editeur, 1996. Jünger applique cette expression au monde (« la puissance typificatrice de l’univers »).
[cite]