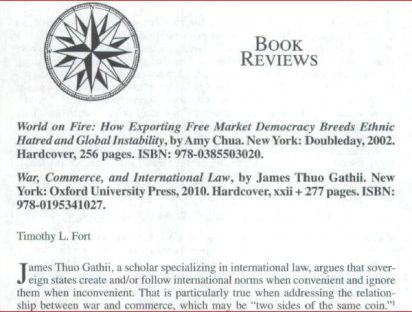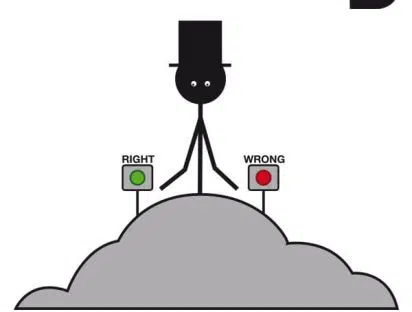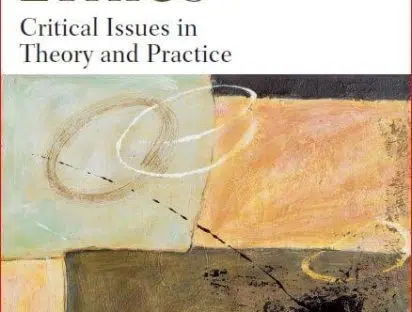Dans le billet précédent, je proposais de me référer à quelques travaux issus de la littérature de l’éthique des affaires au sein desquels le concept de « problème » jouait le rôle principal. Il y en a peu, en vérité, et c’est finalement à un article publié en 2004 dans le Journal of Business Ethics que je consacrerai l’essentiel de ce billet. L’auteur, Donald Morris, s’y intéresse à la définition d’un « problème moral ». De mon point de vue, il est de loin, au sein de l’éthique des affaires académique, l’effort le plus fécond pour réfléchir à cette question essentiellement conceptuelle. Mais avant de résumer et de commenter son argument, je propose quelques définitions générales du concept de « problème ».
Un problème peut être sans solution, à la manière d’un mystère ou d’une énigme, ou il peut présenter des solutions dont la découverte suppose l’exercice de la raison. Selon l’excellent dictionnaire du CNRTL, un problème est, en un sens épistémologique, une « question à résoudre par des méthodes rationnelles ou scientifiques ». Le mot, synonyme de « question » (1), admet souvent un complément de nom qualifiant l’objet du problème : problème d’astronomie, de physique, etc. En mathématiques, un problème est une « question pouvant être résolue à partir des éléments donnés dans l’énoncé », mais parfois, spécialement dans d’autres domaines, y compris ceux relevant de la vie sociale, un problème peut rester, au moins temporairement, sans solution, ce qui correspond à cette définition plus générale : « Question d’ordre théorique ou pratique qui implique des difficultés à résoudre ou dont la solution reste incertaine ». Le sens peut même s’apparenter à celui d’une énigme : « Chose dont il est difficile de déterminer la nature, ou qu’on ne peut expliquer, concevoir » (2).
Ces définitions supposent que le problème soit identifié comme tel, c’est-à-dire qu’une situation ou un fait, par exemple, soulèvent ou constituent effectivement un problème. Les définitions précédentes nous placent face à une « question à résoudre ». Elles ne répondent pas à celle de son émergence, à ce qui fait que telle situation ou tel fait deviennent des problèmes.
C’est un sujet important pour les sciences sociales. Dans un article publié en 1997 dans la revue Social Problems, l’historien Hillel Schwartz se demandait quelle était l’origine, non pas des « problèmes sociaux », mais de l’expression « problème social » (3). Dans le champ de l’éthique des affaires, un sujet un peu voisin, traité sous une perspective non historique et non généalogique, a été abordé pas Nicolas Dahan et Milton Gittens dans un article du Journal of Business Ethics. Son objet est la définition et l’émergence de ce qui est qualifié de « sujet de débat public » (public issue) (4). Mais le concept de « problème » n’y est pas traité en tant que tel. Certes, il entre dans la définition d’un « enjeu » (traduction ici appropriée du mot issue) que les auteurs définissent ainsi : « En gros, un enjeu peut être considéré comme un problème par un acteur qui reconnaît qu’il mérite son attention » – mais l’idée de problème per se n’apporte rien aux facteurs qui expliqueraient l’avènement d’une question au rang de « sujet de débat public ».
Donald Morris, en revanche, propose une exploration du concept de « problème », spécifiquement du concept de « problème moral » (5). Son article est uniquement conceptuel, même s’il l’enrichit de son expérience dans l’enseignement de l’éthique des affaires auprès d’étudiants.
Le souci principal de Morris est de leur proposer une définition d’un « problème moral » qui ne fasse pas référence à des termes moraux. D’abord parce que, en général, l’énoncé (definiens) définissant un terme à définir (definiendum) ne devrait pas contenir le terme à définir. Ensuite parce qu’il est important de remonter aussi loin que possible vers les antécédents d’un problème moral. Si, par exemple, tout ce que nous pouvons identifier à l’origine d’un problème moral est un jugement moral (par exemple un jugement spontané du type : « C’est injuste » ou « C’est scandaleux »), nous nous retrouvons dans la situation du definiendum contenu dans le definiens – une situation que Morris qualifie de « paradoxe ».
À cet égard, cependant, l’auteur reste prudent. Il veut éviter cette situation, non pour une raison logique, mais pédagogique et empirique. Il estime en effet que donner une définition « non morale » (il ne veut pas dire par là : non moralisatrice ou non moralisante) d’un problème moral doit aider les étudiants à reconnaître qu’une question relève de l’éthique :
« Au cours des dernières années, j’ai réalisé qu’il me fallait, pour introduire un enseignement en éthique des affaires, disposer d’une définition d’un problème moral qui n’utilise pas de façon spécifique des termes moraux tels que bon, mauvais ou devoir. Pour des raisons pédagogiques, je voulais une définition qui fournisse les critères permettant de déterminer si un problème donné est un problème moral, sans utiliser les termes moraux les plus communs. […] L’un des objectifs fondamentaux d’un cours d’éthique des affaires est de stimuler la capacité des étudiants à reconnaître à quel moment une question morale émerge ou devrait émerger. D’où la nécessité de déterminer les critères permettant d’affirmer que telle situation d’affaires génère un problème moral. »
Dans la suite de son article, Donald Morris propose une sélection de neuf manuels d’éthique des affaires dans lesquels le lecteur peut trouver des définitions d’un problème moral. Celles-ci sont regroupées en quatre catégories, selon qu’elles sont a) formulées à travers une liste de caractéristiques, b) issues d’un conflit intérieur, c’est-à-dire un conflit dont le sujet fait l’expérience, c) issues d’une opposition entre des vertus et des biens moraux et d) fondées sur des preuves empiriques.
Morris critique chacune des définitions proposées. Celle de William Shaw et Vincent Barry, par exemple, typique de la catégorie a), repose sur des caractéristiques qui semblent répondre à l’impératif de neutralité (définition d’un problème moral sans référence à des termes moraux) que Morris veut respecter : « souci de respecter des obligations, impact de nos actions sur des idéaux significatifs, souci des conséquences » (6). Mais Morris considère que ces critères (dont la neutralité morale reste par ailleurs à démontrer) sont trop vagues. S’ajoute une caractéristique supplémentaire d’un problème moral : le fait qu’il puisse être discuté par des personnes ayant des perspectives éthiques différentes. Mais Morris remarque que des questions morales sont susceptibles de naître à l’esprit d’une personne sans qu’elle en réfère à autrui – elle peut ainsi être amenée à délibérer et à prendre une décision sans que la question soit discutée publiquement.
Autre exemple : celui de l’ouvrage (moins connu) de Jennifer Jackson, qui se situe dans la catégorie c) (7). Pour Jackson, les problèmes moraux sont ceux dans lesquels « notre rôle (ou nos rôles) sont à l’origine de demandes concurrentes qui poussent à agir dans des directions potentiellement incompatibles, comme lorsque l’obligation d’être honnête exige d’agir d’une manière qui nuit aux intérêts de ceux envers lesquels nous avons une obligation de protection » (8). La confiance (un bien moral) entre alors en conflit avec l’honnêteté (une vertu). Mais Morris porte à l’égard de cette définition le même jugement d’imprécision que dans le cas de Shaw et Barry : « Pour l’étudiant débutant (ou le sceptique), il n’en résulte que de vagues impressions ».
Morris ne s’arrête pas là. Il propose sa propre définition :
« Un problème moral est un choix entre différentes actions possibles, fait de façon unilatérale par un individu ou un groupe d’individus, dans lequel une action au moins, parmi celles qui résultent de la décision, conduit à modifier le plan de vie d’un autre individu ou d’un autre groupe d’individus. »
Il reste évidemment à déterminer ce qu’est un « plan de vie ». Et c’est ici que la préoccupation pédagogique de Morris rejoint son souci d’une définition neutre. Car la notion même de plan de vie (life plan) est censée susciter un débat au sein des étudiants assistant à leur premier cours d’éthique des affaires, précisément parce que (selon Morris) « ni l’enseignant ni le texte [la définition ci-dessus] ne proposent une définition toute faite d’un plan de vie ». Or, ce thème est suffisamment pertinent pour que les étudiants « se sentent responsabilisés et impliqués dans la discussion ». Au fond, ce que Morris propose à la discussion est ce qui constitue une vie digne d’être vécue, une « vie bonne ». Son hypothèse est que ceci fournit un point d’entrée substantiel pour constituer un cadre de référence avant aborder, dans la suite du cours, les questions pratiques de l’éthique des affaires.
Morris discute des possibles objections, notamment de celle qu’un étudiant pourrait soulever sous la forme de cette question : « Qu’est-ce que ça peut faire si mon action a une influence sur le plan de vie de quelqu’un d’autre ? » L’auteur reconnaît que l’objection révèle une prémisse cachée (« il est mal de modifier unilatéralement le plan de vie de quelqu’un d’autre »), mais ils admet cette prémisse qui, en outre, si elle devait venir dans la discussion, enrichirait la réflexion, puisqu’il s’agirait alors de traiter du fondement même de l’éthique. Au fond, la méthode de Morris consiste à commencer un cours d’éthique des affaires par un cours d’éthique tout court – un exercice cependant plus difficile qu’il n’y paraît.
Alain Anquetil
(1) Dans son dictionnaire de philosophie, Christian Godin s’attache à distinguer « problème » et « question » : « [Un problème est une] question à résoudre rationnellement par la déduction ou par l’observation. Problème et question s’équivalent (le problème de l’origine de la Lune se pose sous la forme de cette question : « d’où vient la Lune ? »). On peut néanmoins les distinguer de deux façons : a) le problème est plus élaboré que la question (en le posant, on détermine ce que l’on cherche comme susceptible de recevoir une solution ; s’il y a des questions naïves, il n’y a pas de problème naïf) ; b) le problème met en jeu un large contexte. » (C. Godin, Dictionnaire de philosophie, Fayard, 2004.)
(2) Godin souligne qu’« à la différence du mystère, le problème a toujours une solution rationnelle – l’absence de solution (comme souvent en mathématiques) constituant une solution. L’énigme, à la différence du problème, est supposée connue d’au moins un sujet (il n’y a pas d’énigme pour le sphinx, ni pour le criminel). »
(3) H. Schwartz, « On the Origin of the Phrase “Social Problems” », Social Problems, 44(2), 1997, p. 276-296. L’auteur parle également du passage de l’idée de « problème social » (ou de « question sociale ») à la forme plurielle: « problèmes sociaux ».
(4) N. M. Dahan et M. Gittens, « Business and the public affairs of slavery: A discursive approach of an ethical public issue », Journal of Business Ethics, 92, 2010, p. 227-249. Il se trouve qu’au départ de leur enquête, ils se réfèrent aux pratiques esclavagistes des fabricants de chocolat, rappelant qu’en 1909, la firme Cadbury fit un procès en diffamation au journal London Standard qui l’accusait d’hypocrisie à propos du travail des esclaves dans les plantations de cacao et qu’en 2001 le Financial Times relatait le même type d’accusations à l’encontre de producteurs de chocolat (une plainte fut déposée en Californie en 2005, dont l’instruction se poursuite : cf. « Nestlé, Cargill, Archer Daniels Midland lawsuit (re Côte d’Ivoire) »). Ce qui conduit Dahan et Gittens à se demander pourquoi, « exactement cent ans plus tard, des producteurs de chocolat se retrouvent au même point, accusés publiquement de l’un des pires exemples de comportement immoral ».
(5) D. Morris, « Defining a moral problem in business ethics », Journal of Business Ethics, 49(4), 2004, p. 347-357.
(6) W. H. Shaw et V. Barry, Moral Issues in Business, 7ème édition, Belmont, Wadsworth Publishing Company, 1998.
(7) J. Jackson, An Introduction to Business Ethics, Oxford, Blackwell Publishers, 1996.
(8) Aucun exemple concret n’est donné dans le texte, mais Jennifer Jackson, qui s’est intéressée à l’éthique biomédicale (elle est notamment l’auteur de Ethics in Medicine, Cambridge, Polity Press, 2006), en propose dans ce domaine.